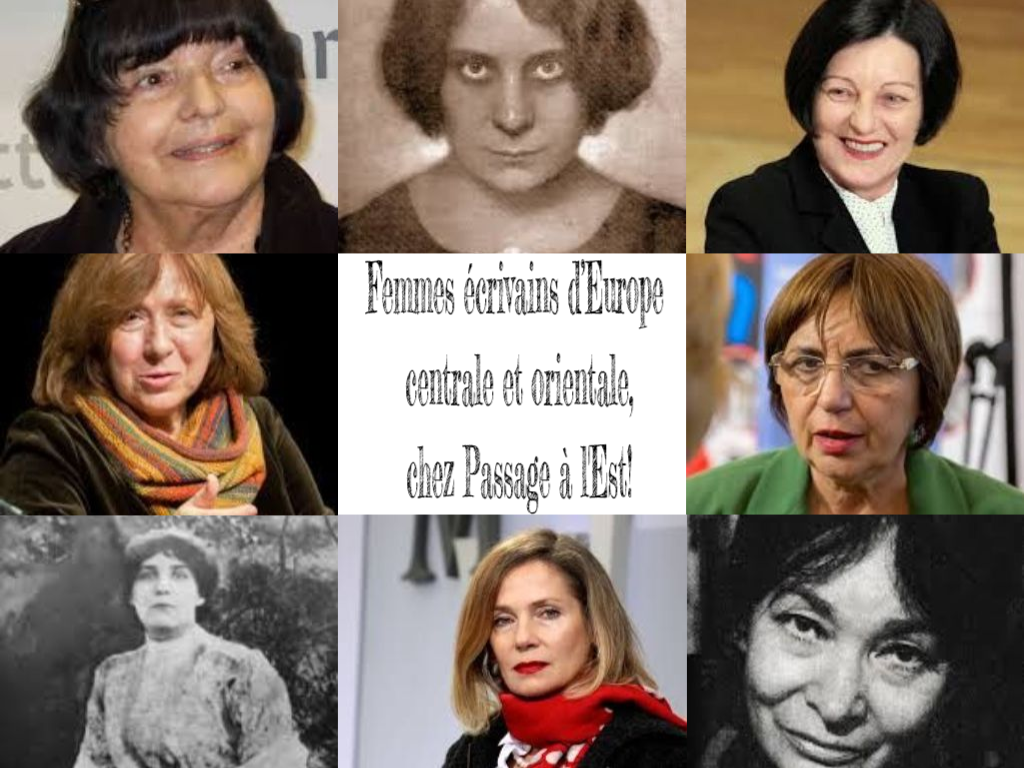Róbert Hász – Les treize jours de l’inspecteur de police Marcell Fábián
Publié : 15/06/2024 Classé dans : 2010s, en hongrois, Hongrie, Polar, Roman historique Poster un commentaire
Fábian Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja : c’est une lecture en hongrois mais une lecture détente quand même. J’ai parfois dû faire appel à mon vieux dictionnaire, tout en sachant que beaucoup des mots que je ne connaissais pas sont passés hors d’usage depuis longtemps : szatócsbolt, par exemple (épicerie) ou konflis (fiacre – un mot important pour le déroulement de l’action et pour la couverture, mais pas pour la vie d’aujourd’hui). C’est normal : le roman a été publié en 2017 mais il se déroule tout au début du XXe, à Zombor et dans ses environs : aujourd’hui la ville est Sombor au nord de la Serbie, tout près de la Croatie, mais en ces temps du livre la ville est majoritairement hongroise et la Serbie de l’autre côté du Danube représente plutôt une échappatoire pour contrebandiers et malfaiteurs.
Zombor, Szanád, Palics, Novo Selo, Doroszló : entre villes et villages joignables à pied, à charrette ou en fiacre par des routes hepehupás (bosselées), le monde de ce roman est un monde mélangé où l’on parle un peu ou beaucoup serbe, où l’utilisation du sparhert pour chauffer et cuisiner fait penser qu’il y a aussi de la présence souabe, où seuls les Hongrois fréquentent le Kaszinó tandis que les Serbes fréquentent leur Csitaonica. C’est aussi un monde où il est tout à fait courant d’employer des domestiques, à la ferme comme en ville et au bureau : c’est l’occasion de se rappeler toutes sortes de mots inutiles (dans la vraie vie) pour différencier tous ces inas, komornyik, cselédlány, hivatalszolga… Pourtant, qu’ils soient valets, domestiques et garçons de bureau, tous auront leur mot à dire et leur rôle à jouer pour arriver au bout de l’intrigue.
Je rajoute deux autres mots utiles pour introduire le sujet : hulla et tetem signifient tous deux « cadavre » et, comme il y aura justement beaucoup de cadavres, mieux vaut garder ces deux mots à l’esprit afin de ne pas être trop souvent surpris. Tout commence justement au plus noir d’une nuit d’un dimanche de novembre, lorsque Marcell Fábián – détective jeune, consciencieux et à la pointe de son temps – est appelé dans la villa d’un notable local pour constater qu’il s’y trouve non pas un, mais deux cadavres : page 30, voilà la première apparition du mot tetem, et aussi d’ailleurs du mot ujjlenyomat – empreinte digitale. Notre détective n’est-il pas à la pointe de la technologie ? Pourtant, il n’a pas besoin d’utiliser de techniques compliquées pour se rendre compte que ces deux corps sont le résultat d’une mise en scène (comme Hercule Poirot, il aime garder ses observations pour lui jusqu’au moment où il jugera bon de (nous) les faire savoir au détour d’une conversation). Une mise en scène donc, mais par qui, et dans quel but ?
Au bout de quelques jours, quelques révélations sont compliquées par l’apparition d’un autre tetem et de nouvelles pistes. Hász aborde tout cela du point de vue du détective et de ses collègues : Milorad Veszelinovics le chef serbe (c’est lui qui écorche à tout bout de champ le nom de « Márszel », au point de faire enrager son subordonné sinon plutôt placide), Winter le poids lourd préoccupé par le délitement de son couple, Mihály le garçon de bureau, le docteur Lichtneckert, et Heindloffer, le lieutenant-colonel qui s’exprime en aboiements brefs et ponctués de points d’exclamation.
S’agit-il de venger une jeune fille séduite et abandonnée ? D’un règlement de compte entre homosexuels ? Cette deuxième option semble vraisemblable mais elle fait frémir le lieutenant-colonel et les autres hommes de la « bonne société » de Zombor, car cette affaire concerne l’un d’entre ces hommes. Marcell sait bien que l’explication officielle, que le journal s’apprête à publier un mercredi, soit dix jours après la découverte des deux premiers cadavres, ne tient pas debout mais est là pour préserver certaines apparences.
A fenébe, nem komplikálja kicsit túl ? (…) Öngyilkosság. Tiszta sor. Schlussfertig !
(C’est Heindloffer qui s’exprime, après la découverte des premiers cadavres, pour dire que Marcell et collègues compliquent bien trop les choses et que l’explication par un suicide lui faciliterait beaucoup la vie)
Le lecteur, qui voit qu’il reste trois jours sur les treize promis par le titre et 100 pages avant la fin du livre, et qui suppose que les quelques histoires parallèles et faussement anecdotiques (qui sont les vrais parents de Marcell ? et pourquoi la vieille Metzker réapparait-elle justement maintenant pour se plaindre que la disparition de son fils, six ans auparavant, n’a pas été résolue ?) n’ont pas été ajoutées là pour rien, sait qu’il y aura un rebondissement. Et c’est le cas. Jusqu’à jeudi matin, le rythme du livre est assez tranquille, la tension pas trop élevée car les meurtres ont lieu hors champ et notre détective est plutôt dans la réaction et la cogitation, mais cette tension augmente d’un grand coup quand, au beau milieu d’une forêt solitaire et enneigée, alors qu’il va justement prendre des nouvelles de la vieille Metzker, c’est Marcell lui-même qui se retrouve du mauvais côté de son propre pistolet. Et gentiment, c’est son meurtrier qui explique au détective toute l’histoire (aussi compliquée et finalement plausible que si elle avait été inventée de bout en bout par un romancier), avant de tuer Marcell et de faire disparaitre son corps pour toujours… ou pas. On ne peut quand même pas faire mourir Marcell, qui a quitté sa femme alitée pour cause de migraine ce matin-là, et qui doit de toute manière encore apparaitre dans les deux volumes suivants de la série !



En lisant ce sympathique roman bien maitrisé, j’ai souvent pensé à la série de polars historiques fin XIXe-début XXe des Maryla Szymiczkowa, autour de la figure de Zofia Turbotyńska, mais en un peu moins « cozy » car les cadavres sont quand même nombreux et leurs morts parfois saisissantes (10 hullam, sans compter le pope du premier chapitre – ça fait beaucoup comparé par exemple à Madame Mohr a disparu, le premier volume de la série polonaise). Comme pour la Cracovie de la détective (amateur) Turbotyńska, la géographie du détective (professionnel) Marcell Fábián est bien sûr recréée avec minutie ; dans les deux volumes suivants, on sortira de la Voïvodine pour aller jusqu’à Fiume (Rijeka) et même jusqu’au Nouveau Monde. Une lecture à continuer donc, aussi pour voir comment l’auteur développera ses personnages.

Pour le moment, ce livre n’est pas traduit (sauf en bulgare) mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas lire Róbert Hász en français, grâce aux traductions de Chantal Philippe publiées chez Viviane Hamy, de quatre romans tous différents : Le jardin de Diogène, La forteresse, Le prince et le moine, Le passage de Vénus.
Hász Róbert : Fábian Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja. Kortárs kiadó, 2017.