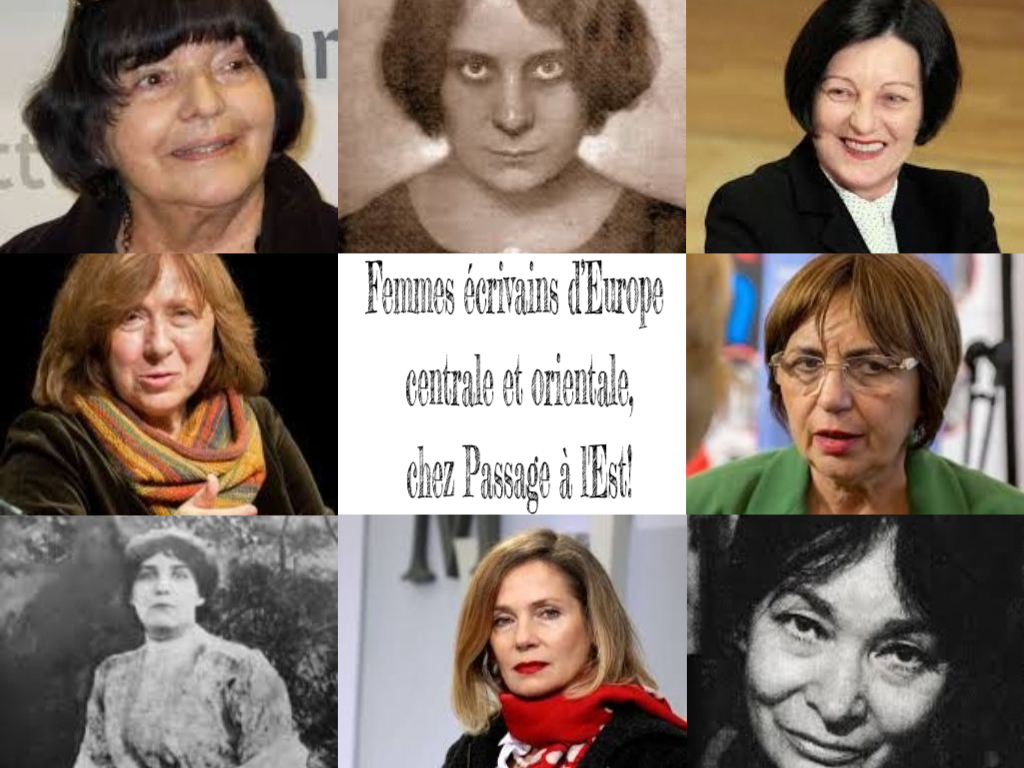Paweł Huelle – Moving House
Publié : 27/03/2024 Classé dans : 1990s, En anglais, Pologne 4 Commentaires
Des sept histoires qui composent ce recueil, celle du titre, « Moving House », est la plus courte, mais c’est l’une de celles qui évoque le plus distinctement la question de la présence du passé collectif dans l’imaginaire individuel. Ce thème est filtré par la voix d’un narrateur : un narrateur adulte, très probablement toujours le même, probablement proche de l’auteur et qui, se souvenant de différents épisodes de sa vie et surtout de son enfance, est plus ou moins distinctement conscient que, né après une période de rupture, il est l’héritier d’un passé peu évoqué mais qui se fait encore sentir.
Lire la suite »Vizma Belševica – Bylle
Publié : 11/01/2024 Classé dans : 1990s, Nouvelles publications, Service Presse, traduit du letton | Tags: Vizma Belševica 8 CommentairesPublié au début des années 1990 et disponible depuis un peu plus d’un an en traduction française, Bylle est le récit des aventures d’une petite fille qui, au cours des années 1930, grandit dans un quartier populaire de Riga.

Habilement construit en une suite de chapitres aussi thématique que chronologique et formant un tout cohérent, le roman dépeint l’univers urbain – mais encore très proche de la vie rurale – de Bylle, faisant doucement s’égrener les années jusqu’à celle de son entrée à l’école : une entrée tardive pour nous (elle a environ huit ans), et dont on devine tout juste qu’elle va bientôt être suivie de l’irruption de la Seconde Guerre mondiale en Lettonie. Cette guerre fournira le contexte du volume suivant (en cours de traduction) de ces aventures – semi-autobiographiques – de Bylle, et on ne peut que supposer que ses effets se feront durement ressentir dans la famille de Bylle, tant celle-ci vit déjà très modestement pendant ces années 1930.
Lire la suite »Besnik Mustafaj – Le tambour de papier
Publié : 03/12/2023 Classé dans : 1990s, Albanie | Tags: Besnik Mustafaj 2 CommentairesJakup Cena eut l’impression de saisir dans l’orientation de l’Histoire naissante du pays une chose essentielle qu’il ne pouvait malheureusement avouer à personne : le nouveau chef du gouvernement voulait (…) un peuple abêti, mais fidèle et enthousiaste.
J’ai trouvé ce Tambour de papier chez un bouquiniste de Perpignan, et comme pour Sous un ciel qui s’écaille à Saint-Etienne, c’était le seul livre d’Europe centrale, de l’Est et des Balkans de la boutique. J’aurais peut-être dû le laisser pour que quelqu’un d’autre s’en empare ? Mais je n’avais encore jamais lu Besnik Mustafaj et je suis repartie avec.

Le tambour de papier, ce sont neuf histoires qui se passent toutes dans l’Albanie d’Enver Hoxha, chaque nouvelle histoire avançant un peu dans le temps, de 1944 au début des années 1980. On sait bien, en le lisant, qu’il s’agit d’une Albanie totalitaire, enfermée dans une vision toute particulière et paranoïaque du communisme, marquée par une grande privation de liberté de ses citoyens. Ce ne sont pourtant pas les mots que Besnik Mustafaj met en avant dans les pages de son livre : avec l’air de ne pas trop y toucher, avec ses personnages souvent tirés des rangs des « simples » Albanais, c’est surtout la paranoïa collective et ses ramifications individuelles qu’il décrit dans ces récits où la question de la folie n’est jamais très loin.
Lire la suite »Aharon Appelfeld – Histoire d’une vie
Publié : 27/01/2023 Classé dans : 1990s, hébreu, Holocauste, Lectures communes 32 CommentairesAt a very early age, and before I knew that fate would push me towards literature, instinct whispered that without an intimate knowledge of language my life would be superficial and impoverished.
A un très jeune âge, et avant de savoir que le destin me conduirait vers la littérature, l’instinct m’a murmuré que, sans une connaissance intime d’une langue, ma vie serait superficielle et appauvrie.

Aharon Appelfeld (1932-2018) ne se considérait pas comme un écrivain de l’Holocauste : « Il n’y a rien de plus exaspérant » que d’être étiqueté écrivain de l’Holocauste, écrit-il dans son Histoire d’une vie. Son expérience personnelle du milieu du XXe siècle, alors qu’il n’était qu’un enfant, s’inscrit cependant dans la constellation de ce qui, autour de l’existence et de la signification des camps – fait toute la complexité de l’Holocauste.
En choisissant ce titre parmi toute l’œuvre de l’écrivain, j’avais déjà quelques mots-clés biographiques en tête : né en Bucovine alors roumaine mais encore imprégnée de l’influence de l’Autriche-Hongrie ; orphelin ; traduit de l’hébreu ; survivant de l’Holocauste ; et, le plus évident, Juif. Mais ces mots-clés ne disent finalement pas grand-chose sur l’enfance qu’Aharon Appelfeld décrit par bribes dans Histoire d’une vie, non avec une volonté documentaire mais en s’appuyant d’abord sur ses quelques souvenirs pour construire un texte autobiographique qui place la langue et la mémoire au cœur de son parcours d’écrivain.
Lire la suite »Wiesław Myśliwski – L’Horizon
Publié : 27/11/2022 Classé dans : 1990s, Margot Carlier, Pologne, Roman, Service Presse | Tags: Mysliwski 5 CommentairesJe n’ai compris qu’à la mort de l’oncle Władek que je n’avais jamais vraiment quitté cet endroit. Leurs tombes à tous m’indiquaient en fait ma place dans le monde. Peut-être même qu’ici se trouvait le centre de mon horizon, car nulle part ailleurs je n’éprouve cette douleur déchirante qu’avec eux, c’est aussi moi qui meurs un peu, et pas seulement le monde qui m’entoure. Je le ressens de façon si banale, si évidente, que cette douleur devient un émerveillement, comme si je touchais à l’extraordinaire mystère de la beauté.

Publié il y a déjà plus de 25 ans, L’Horizon est un long et magnifique roman sur la vie, sur l’enfance, sur le royaume individuel de la mémoire et sur la possibilité de sa transmission. C’est aussi, de la part de son auteur Wiesław Myśliwski, une formidable leçon d’écriture, épousant les fluctuations de la mémoire et de l’imagination tout en se jouant des contraintes de la chronologie.
Lire la suite »Valentīns Jākobsons – Petit déjeuner à minuit
Publié : 19/01/2022 Classé dans : 1990s, Lettonie, Témoignage, URSS | Tags: Jakobsons 7 Commentaires
Deuxième partie de ma séquence dédiée aux récits marqués par l’expérience du stalinisme, ce livre porte le sous-titre « Chroniques d’une déportation ». Cela rend les premières pages un peu curieuses, car on se croirait dans un roman d’espionnage, avec ce jeune homme qui, près d’un village de pêcheurs, tue le conducteur d’une « magnifique Chevrolet noire » avant de s’éclipser en direction de la plage.
Très rapidement le mystère est levé et l’explication permet de faire connaissance tant avec le narrateur qu’avec l’atmosphère de la Lettonie de la fin des années 1930. Le jeune meurtrier est l’un des voisins d’été du narrateur, un des « fougueux Germano-Baltes » prêts à « se donner corps et âme au Reich et au Führer ». C’est l’été, et le narrateur, un lycéen letton qui se prépare à entrer en dernière année, offre dans le premier chapitre un commentaire sur l’actualité entremêlé à dessein d’un raccourci sur ses activités estivales :
Lire la suite »L’Armée rouge, si éprise de paix, envahit la Pologne. Varsovie vient déjà d’être rasée par les Allemands, dans quelques jours la Pologne cessera d’exister. Il n’y aura plus d’état polonais. Incroyable. Avec Néolith, nous allons voir Werner Baxter dans Le Caballero Mexicain. Warner Baxter est mon acteur favori. Sans oublier Hans Albers.
Pologne/Ukraine/Kazakhstan et Lettonie/Sibérie : deux récits marqués par l’expérience du stalinisme
Publié : 15/01/2022 Classé dans : 1990s, 2000s, Kazakhstan, Lettonie, Pologne, Récit autobiographique, Témoignage, Ukraine, URSS 12 CommentairesEn proposant un retour en livres sur trente années d’indépendance des pays issus de l’ex-URSS, j’ai plus ou moins cantonné chaque pays à « sa » langue, « sa » littérature, « son » expérience nationale. La réalité est toujours plus compliquée que ça : la trajectoire des pays et des peuples qui sont tombés dans l’escarcelle de l’ex-URSS avant d’en ressortir le montre bien. Les deux livres dont je vais prochainement parler ici sont deux exemples des liens douloureux qui ont été tissés d’un coin à l’autre de cet immense empire, notamment (mais pas exclusivement) durant la période stalinienne.
Le premier livre est un récit de vie qui débute en 1923 en Volhynie (aujourd’hui en Ukraine) et fait un long et terrible voyage vers le Kazakhstan. Le récit se termine en 1951.
Le second livre est aussi un récit de vie, mais sous une forme plus distante et plus littéraire. Son auteur est lui aussi né au début des années 1920, mais c’est de sa Lettonie natale qu’il est déporté vers la Sibérie, au tout début de la Seconde Guerre mondiale.
Ce sont le récit d’une femme et d’un homme dont on peut se demander comment ils ont bien pu survivre. Le premier titre donne un élément de réponse : c’est Accrochée à la vie, de Franceska Michalska. Le second livre est à la fois un récit et un recueil de récits, et il porte le titre du dernier chapitre : c’est Petit déjeuner à minuit, de Valentīns Jākobsons.
Le hasard a fait que j’ai lu ces deux livres à peu près au même moment que l’annonce de la dissolution de l’ONG russe Memorial par la Cour suprême russe – une ONG qui œuvre depuis 1989 pour faire la lumière sur les millions de victimes de la dictature stalinienne – des victimes dont les auteurs de ces deux livres (tous deux survivants) ont fait partie.


Ádám Bodor – La visite de l’Archevêque
Publié : 31/03/2021 Classé dans : 1990s, Hongrie, Lectures communes | Tags: Bodor 16 Commentaires
La visite de l’archevêque est un livre magistral. Par la voix d’un narrateur de l’ombre, Ádám Bodor y établit une atmosphère d’étrangeté, d’irréel et surtout de malaise et de menace permanente. L’histoire, les personnages, les lieux sont une grande allégorie dont l’auteur place les clés autant dans l’imagination des lecteurs que dans le cauchemar du XXe siècle est-européen dans lequel il a grandi.
Sándor Tar – Tout est loin
Publié : 26/03/2021 Classé dans : 1990s, Hongrie, Lectures communes | Tags: Tar 12 Commentaires
Un ami me disait récemment, à propos de Sándor Tar, qu’il l’appréciait parce que c’est un auteur qui parlait d’un pan de la société hongroise qui est très peu représentée dans la littérature hongroise, notamment parce que peu d’écrivains en sont issus. Né dans une famille de paysans pauvres de l’Est de la Hongrie en 1941, ouvrier puis contremaître d’usine, chômeur, décédé en 2005 à l’Est de la Hongrie en 2005, Sándor Tar était aussi l’auteur de nombreux romans et nouvelles. Parmi ceux-ci, deux courts romans et un recueil de nouvelles ont été traduits en français à la fin des années 1990 et au début des années 2000 : Tout est loin, Choucas et autres nouvelles, et Notre rue.
Juste une année sépare la publication hongroise de Tout est loin, son premier roman, de la parution de la traduction française, en 1996. C’est un roman très resserré, une centaine de pages livrées d’une traite, qui lèvent un coin de rideau sur la vie de quatre hommes. Laboda, Vári, Madari et Barna travaillent tous au même endroit – ils sont ouvriers sur un chantier – et vivent tous au même endroit – une « tanière d’hommes nauséabonde et désordonnée » avec chambre, cuisine et salle de bain, en sous-location chez la vieille Adél. Lorsqu’ils ne travaillent pas et ne dorment pas, ils sont au bistrot, ou à la discothèque, ou à la recherche d’une aventure d’un soir. Lire la suite »
Ida Fink – Le voyage
Publié : 01/02/2021 Classé dans : 1990s, Femmes écrivains, Holocauste, Pologne, Récit autobiographique | Tags: Ida Fink 7 CommentairesElle avait parlé d’une voix faible, son père ne l’avait pas entendue. Il demanda si c’était une urgence. Elle répéta alors, plus fort cette fois : « C’est nous, c’est nous. »
Elle l’entendit pousser un cri. Elle entendait ses pas, il courait jusqu’à la porte. En courant, il criait leurs prénoms.
 C’est peut-être l’un des passages les plus émouvants de ce beau roman dur, saisissant et d’inspiration fortement autobiographique, lu dans le cadre des Lectures communes autour de l’Holocauste.
C’est peut-être l’un des passages les plus émouvants de ce beau roman dur, saisissant et d’inspiration fortement autobiographique, lu dans le cadre des Lectures communes autour de l’Holocauste.
Katarzyna et Elżbieta, Joanna et Jadwiga, Maria et Barbara : les prénoms ne manquent pas et pourtant nous ne connaitrons pas ceux que crie le père dans ce passage qui clôt presque le roman. Cette multiplicité des noms cachant l’absence des vrais noms est à l’image de l’ensemble du récit, où la nécessité de brouiller les pistes afin de survivre est la principale préoccupation des protagonistes.
Katarzyna, donc, deviendra Joanna, puis plus tard Maria, chaque fois avec un nom de famille différent et inventé. Derrière ces identités de façade vit une jeune fille que les rafles des Einsatzgruppen forcent à assumer ses origines juives en la mettant sur leur liste des personnes à exécuter, avant de la forcer à rejeter cette même association afin de se donner une chance de survivre. Lire la suite »