Wiesław Myśliwski – L’Horizon
Publié : 27/11/2022 Classé dans : 1990s, Margot Carlier, Pologne, Roman, Service Presse | Tags: Mysliwski 5 CommentairesJe n’ai compris qu’à la mort de l’oncle Władek que je n’avais jamais vraiment quitté cet endroit. Leurs tombes à tous m’indiquaient en fait ma place dans le monde. Peut-être même qu’ici se trouvait le centre de mon horizon, car nulle part ailleurs je n’éprouve cette douleur déchirante qu’avec eux, c’est aussi moi qui meurs un peu, et pas seulement le monde qui m’entoure. Je le ressens de façon si banale, si évidente, que cette douleur devient un émerveillement, comme si je touchais à l’extraordinaire mystère de la beauté.

Publié il y a déjà plus de 25 ans, L’Horizon est un long et magnifique roman sur la vie, sur l’enfance, sur le royaume individuel de la mémoire et sur la possibilité de sa transmission. C’est aussi, de la part de son auteur Wiesław Myśliwski, une formidable leçon d’écriture, épousant les fluctuations de la mémoire et de l’imagination tout en se jouant des contraintes de la chronologie.
De Myśliwski, je n’avais lu jusqu’ici que son Kamień na kamieniu (1984 ; dans la traduction anglaise de Bill Johnston chez Archipelago Press : Stone upon Stone), et donc pas encore L’art d’écosser les haricots (2006, paru en français chez Actes Sud dans la traduction de Margot Carlier en 2010), qui avait été si bien reçu en France, et donc pas non plus La dernière partie, son autre roman disponible en français (Actes Sud, 2016). J’avais beaucoup aimé Stone upon Stone, pour la merveilleuse oralité du roman et pour le portrait qu’il fait d’une Pologne rurale du XXe siècle. De ce roman, un épisode du quotidien m’était resté en mémoire : celui où le narrateur évoque la dernière miche de pain de la maisonnée, la miche asséchée qui fait saliver les enfants mais qui, conservée sur une poutre hors de portée des petites mains, doit servir à bénir les champs où sera semé le nouveau blé. C’est tout un drame du quotidien, et un rituel de la vie rurale, qui se déroule autour de cette miche.



Dans L’Horizon, un chapitre en particulier m’est, plusieurs mois après ma lecture, resté à l’esprit et c’est aussi à un objet du quotidien que le narrateur-auteur consacre ce chapitre, intitulé « A la recherche de la chaussure perdue » (je ne suis d’ailleurs pas la seule à m’être attardée sur ce chapitre). Si je m’en souviens si bien, c’est entre autres raisons parce que c’est lui qui m’a fait penser à quel point les objets de la vie courante, et en particulier les vêtements, sont importants dans ce livre : les vêtements qu’on a, mais surtout ceux qu’on n’a pas, ou plus. C’est comme si, dans le roman, ils jouaient le rôle de crochets auxquels le narrateur peut accrocher ses souvenirs du monde lointain de son enfance. Ils soulignent aussi que le roman se déroule dans une famille et à une époque où certains objets de la vie normale ont été accessibles mais ne le sont plus, et où il ne reste plus qu’à s’accrocher au rêve d’y avoir accès à nouveau plus tard. Par-delà l’expression d’une perte de statut social, ces vêtements, si discrètement tissés dans la texture du roman, sont aussi l’expression des stratégies de survie mentale des parents, que ce soit pour se bercer de l’illusion que le père guérira et retrouvera un bon emploi, ou que ce soit celle qu’à la période de guerre durant laquelle se déroule une bonne partie du roman prendra fin et que la vie pourra alors reprendre son cours avec les mêmes repères qu’auparavant.
Au moment de la perte de la chaussure, qui occupe donc une bonne partie d’un long chapitre, la famille – la mère, le père, et Piotr, le fils et personnage central (qui, plus tard en tant qu’adulte, occupe aussi le rôle de narrateur) – est en effet en quête d’un endroit sûr pour se loger, le refuge temporaire chez les grands-parents maternels ayant dû être abandonné face à l’avancée du front. Occupants allemands d’un côté, armée soviétique de l’autre – les deux groupes d’étrangers sont bien là dans le roman, à coups de bourgmestres inquiétants, de ligne de front qui avance et qui recule, et de cheptels de vaches en route vers l’Est. Mais bien que les souvenirs de Piotr coïncident en grande partie avec les années de la Seconde Guerre mondiale, la guerre en elle-même n’est pas le sujet du roman.
Piotr, qui n’a qu’une dizaine d’années à ce moment-là, n’évoque pas vraiment – à travers les souvenirs de l’homme qu’il est devenu plus tard – leur vie d’avant la guerre, mais c’est peut-être aussi parce que tout le roman commence avec une photo prise lorsque la famille s’est déjà réfugiée à la campagne : bien des années plus tard, le narrateur décrit son père, ce « petit homme maigrichon (…) avec ses yeux exorbités, son pardessus en gabardine trop ample, écrasé sous un chapeau trop grand pour lui » et qui l’accompagne, lui l’enfant « vêtu d’un habit de marin bleu foncé, culotte courte et casquette blanche sur la tête, socquettes et sandales aux pieds ».
Nous nous tenons par la main, le regard fixé dans le lointain. Mon père a les yeux écarquillés, moi je les plisse à cause du soleil. Ce sont bien ses yeux qui paraissent les plus nets sur la photographie, ils sont les seuls à s’extraire de la grise monotonie. Comme si toute la lumière du soleil s’y était concentrée, leur redonnant leur véritable couleur – pas aux feuilles ni au ciel, non, mais aux yeux écarquillés de mon père.
Ce prologue, au cours duquel le narrateur contemple cette photo, est d’emblée un exemple fascinant de la manière qu’a Myśliwski d’écrire les méandres et les limites de la mémoire, de laisser s’entremêler les différentes temporalités, et de faire revivre ceux et celles qui ne sont pas présents sur la photo. Dans cette première page du texte, un premier paragraphe décrit la photo, un deuxième émet une supposition sur les circonstances dans lesquelles a été prise la photo, et le troisième nous plonge déjà dans l’atmosphère familiale que la photo n’a pas captée, comme si les décennies écoulées entre la contemplation de la photo et cet hypothétique dimanche où elle a été prise avaient été balayées d’un revers de la main. Dès ce troisième paragraphe, nous sommes sortis, avec le narrateur, du domaine du souvenir d’un dimanche précis pour entrer dans celui de cet hypothétique dimanche, fait de la somme de tous les dimanches vécus ou imaginés, et de toutes les discussions imaginées ou entendues, dans cette ferme familiale.
Tout le roman est ainsi construit, un souvenir en appelant un autre, une voix en remplaçant une autre, au sein d’un cadre temporel (la guerre et l’immédiat après-guerre, c’est-à-dire l’enfance et l’adolescence de Piotr) dont le narrateur s’échappe rarement pour évoquer, si brièvement, des passages de sa vie d’ensuite.




A l’époque, j’ignorais encore tout d’Icare, mais lorsque je regardais depuis le sommet de la colline la plaine qui s’étendait en contrebas, j’avais une envie folle de déployer les bras, de les battre dans l’air et de prendre mon envol, haut, de plus en plus haut, de tracer un ou deux cercles au-dessus des maisons, avant de me laisser planer jusqu’aux montagnes de Poivre pour me poser sur leur versant bombé, ou bien sur l’une des arches arc-boutées du pont ferroviaire tout proche. Ou bien encore de survoler la Vistule, de suivre son cours jusqu’à sa source, jusqu’à l’épuisement.
Dans sa traduction française, L’Horizon fait 560 pages et il serait impossible – et de toute manière peu désirable – d’évoquer tous les personnages, les menus événements, et les lieux qui font la beauté tendre et nostalgique de cette reconstruction d’une enfance lointaine. Après tout, c’est tout un monde que recrée le narrateur lorsqu’il se souvient de son enfance, ou plutôt deux mondes : celui d’abord de la campagne, du chien Kruczek, des oncles et tantes rassemblés dans cette ferme, et des autres personnes – le bourgmestre, le Gefreiter photographe, le soldat Ivan, Shmoul et sa fille Sulka – qui gravitent autour de la ferme. Le deuxième est celui du quartier aux Sternes, dans lequel la famille emménage grâce aux demoiselles Poncki – « Ewelina, ou bien Roza » – dont l’amour du tango et les tasses de cacao illuminent les pages du roman.
Entre la campagne et la ville, il y a cette marche au cours de laquelle le narrateur a perdu sa chaussure, un épisode qui pourrait paraître si anodin mais qui est lui aussi illustrateur de l’ossature discrète et travaillée du roman. Ainsi la chaussure apparait-elle d’abord au moins une centaine de pages avant ce fameux chapitre, et on lit déjà à ce moment-là (sans savoir l’importance qu’elle prendra plus tard) qu’elle a été perdue. Dans ce passage, le narrateur décrit la visite qu’il fait avec sa mère chez l’instituteur, lorsqu’ils sont déjà dans le quartier aux Sternes : « lors de notre visite chez l’instituteur, ma mère se montra très incommodée de ses mains », écrit-il, car « il lui manquait justement le sac et les gants en cuir noir, qu’elle avait l’habitude de porter avec son tailleur gris ». Les gants avaient simplement été perdus durant les tourbillons de la guerre ; quant au sac, ajoute-t-il, un cordonnier s’en était servi pour fabriquer une chaussure pour Piotr. Pourquoi il avait fallu fabriquer une seule chaussure, et qu’était-il arrivé à l’ancienne – le narrateur éclaircit ce non-mystère dans la phrase suivante, très factuelle, avant de revenir à la visite chez l’instituteur.
La mention suivante de la chaussure donne lieu à un type de scène qui revient à plusieurs reprises au cours du roman, celui du tableau de famille : c’est une scène extraordinairement vivante, presque comparable à un tableau biblique, si ce n’est qu’au lieu de célébrer un nouveau-né posé sur la paille d’une étable et baignant dans une lumière douce et chaude, c’est une chaussure qui est posée au centre du tableau. On y voit les membres de la famille de la ferme qui chacun à leur tour regardent, palpent, tournent et retournent la chaussure de remplacement apportée par le cordonnier, afin de décider s’il s’agit, ou non, d’une copie exacte de la chaussure restante. Ce n’est qu’au chapitre suivant, à rebours du temps, qu’arrive le récit de cette journée qui est d’abord celle d’un exode, devient celui d’une chaussure perdue et finit par être le portrait d’une femme, la mère de Piotr, tiraillée entre la mémoire d’un passé perdu et la nécessité d’aller de l’avant pour faire face aux responsabilités de la vie quotidienne.
J’ai fini par me dire que la chaussure n’était qu’un prétexte. Au fond, il s’agissait de tout autre chose, c’était juste un moyen que ma mère avait trouvé pour évacuer un peu de cette douleur qui la submergeait. Mais je n’ai jamais vraiment compris pourquoi elle s’était focalisée sur cette chaussure.
Elle m’avait reproché cette chaussure jusqu’à la fin de sa vie. De même qu’elle avait reproché à mon père de la laisser seule. Elle considérait sa mort non pas comme une chose inéluctable, mais comme une trahison, un acte délibéré qu’il avait fomenté en secret, sans la tenir au courant.
Dans ce roman consacré à ce qui fait l’horizon d’une vie, le père, homme très diminué par la maladie, obligé de cacher son passé d’officier de l’armée polonaise, apparait plutôt en arrière-plan dans les souvenirs de Piotr. Sa longue maladie, distillée tout au long du roman, est cependant l’occasion de très beaux passages sur la création – et la transmission – de la mémoire, notamment autour de l’escalier qui, du quartier aux Sternes, brave la raideur de la pente qui mène vers le centre de la ville. Enfant, Piotr l’empreinte à contrecœur pour monter avec son père chez le médecin : dans l’esprit du narrateur, cet escalier est étroitement associé aux récits de batailles mythiques que lui fait son père à mesure qu’ils s’élèvent au-dessus de la plaine, et qui resteront parmi ses plus forts souvenirs d’un homme qu’il a à peine connu. Bien des années plus tard, lorsque ce quartier insalubre est déjà en train d’être démoli, c’est avec son propre fils que Piotr redescend cet escalier et qu’il s’abandonne au silence de ses souvenirs, rythmé par les secousses de la roche brisée par les engins de chantier, dans un tremblement qui « enfermait les derniers échos des batailles qui s’étaient déroulées sur cette plaine ». Descendant l’escalier, « le seul vestige qui avait pu être épargné », il effleure la rampe « devenue bien lisse. Avec toutes ces mains qui la tenaient ! »
Pourtant, peu de gens vivaient dans le quartier aux Sternes. On pourrait même s’imaginer une chaîne de mains glissant sur cette rampe, avec aussi les miennes, celles de tes grands-parents et des demoiselles Poncki.
C’est avec une vieille photo, « épuisée par le poids de la mémoire » d’un homme aux yeux « toujours tristes » et de son fils « ébloui par le soleil » que débute la longue méditation qui fait cet Horizon. C’est aussi avec une photo, celle – peut-être plus imaginée que réelle– d’un père, Piotr, avec son jeune fils au bord de la plage, que se clôt le roman. Le temps passé entre ces deux photos, et celui qui court ensuite jusqu’au point de vue encore plus tardif du narrateur, est celui d’une vie somme toute assez ordinaire pour son temps. L’évocation de ce passé, et des gens qui le peuplent, contraste tout de même avec cette absence que le narrateur effleure sans jamais vraiment s’y attarder, celle d’Anna. Les mots, si nombreux par ailleurs et si prêts à faire revivre tel ou tel souvenir, se font plus rares, et les évocations plus fugaces, lorsqu’il s’agit de la jeune fille dont il tombe amoureux et qu’il épouse, mais dont la mort est annoncée presque dans le même temps que l’est la venue de leur fils.
Malgré cela, et malgré l’impression que l’histoire d’Anna fait partie des souvenirs que le narrateur ne saura pas transmettre à son fils, c’est plutôt un sentiment d’apaisement qui règne sur ce roman envoûtant, méditatif, aussi superbement écrit qu’il est traduit par Margot Carlier.
A l’occasion de la parution de cette traduction, celle-ci avait évoqué « l’émotion ressentie à la lecture de ce merveilleux roman » ainsi que les dix années qu’il lui avait fallu pour trouver un éditeur. Le roman est finalement sorti chez Actes Sud en octobre dernier, quelques mois avant le 90e anniversaire de Myśliwski. 25 ans auparavant, en 1996, la parution en Pologne de L’Horizon avait valu à son auteur de recevoir le prix littéraire Nike, le plus prestigieux prix littéraire polonais. Dix ans après cette publication, celle de Traktat o łuskaniu fasoli / L’art d’écosser les haricots faisait de lui le premier écrivain à être par deux fois lauréat du prix Nike.
Encore une dizaine d’années plus tard, lors de la parution de Księgi Jakubowe / Les livres de Jacób, Olga Tokarczuk recevait à son tour pour la deuxième fois ce prix littéraire, après une première récompense obtenue lors de sa publication de Bieguni / Les pérégrins en 2008.
Avec cette chronique de L’Horizon, je mets fin à ce petit voyage à travers la littérature polonaise dans lequel je m’étais embarquée début octobre avec, justement, une chronique de Les pérégrins et qui m’a ensuite emmenée ici, puis là, et enfin là. Je continue également ma contribution à l’initiative « Voisins voisines », qui vise à faire découvrir la littérature européenne contemporaine.
Wiesław Myśliwski, L’Horizon (Widnokrąg, 1996). Traduit du polonais par Margot Carlier. Actes Sud, 2021.
Un petit ajout à ma chronique : L’Horizon, c’est aussi l’un de ces romans qui mentionnent Les gars de la rue Paul ! « On n’arrivait plus à le consoler, tellement il pleurait », dit la mère de Piotr à propos de son fils lisant ce roman. Pourquoi est-ce que je mentionne Les gars de la rue Paul ? J’explique dans cette chronique ce qu’est ce classique hongrois de la littérature jeunesse du début du XXe siècle.


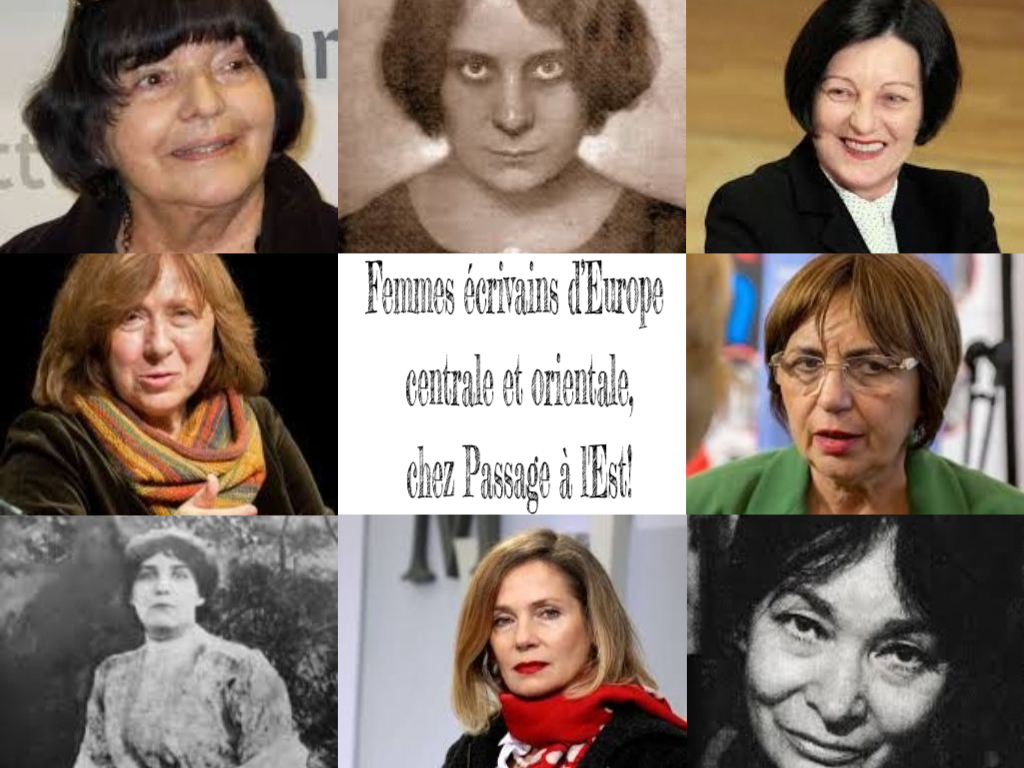

Le titre semble particulièrement bien choisi pour l’atmosphère de ce roman. Ce que tu dis de la chaussure perdue me rappelle le moulin à café de O.Tokarczuk dans le roman Dieu, le temps… Je me trompe peut-être mais ta chronique de ce livre m’évoque ce roman.
Je pense qu’il y a dans les deux romans l’idée de microcosme (beaucoup plus large dans le cas de L’Horizon), mais L’Horizon est beaucoup plus ancré dans une réalité humaine reconnaissable. Cependant il va falloir que je me rafraichisse la mémoire concernant le role du moulin à café, que je n’avais même pas cité dans ma chronique! En tout cas, ce sont deux très belles écritures.
[…] Par petits bouts – Weronika Gogola, Passage à l’Est! Madame Mohr a disparu – Maryla Szymiczkowa, Passage à l’Est! Wiesław Myśliwski – L’Horizon, Passage à l’Est ! […]
[…] et de là en français, « les petits garçons de la rue Pavlov ». Tout récemment, c’est dans L’Horizon, un roman (lui aussi de nature en partie autobiographique) traduit du polonais, que j’ai été […]
[…] tant aimé la construction du livre. Je me suis peut-être trop interrogée, d’ailleurs, car ma chronique n’a pas été parmi les mieux aimées de 2022 mais elle est toujours là et prête à être […]