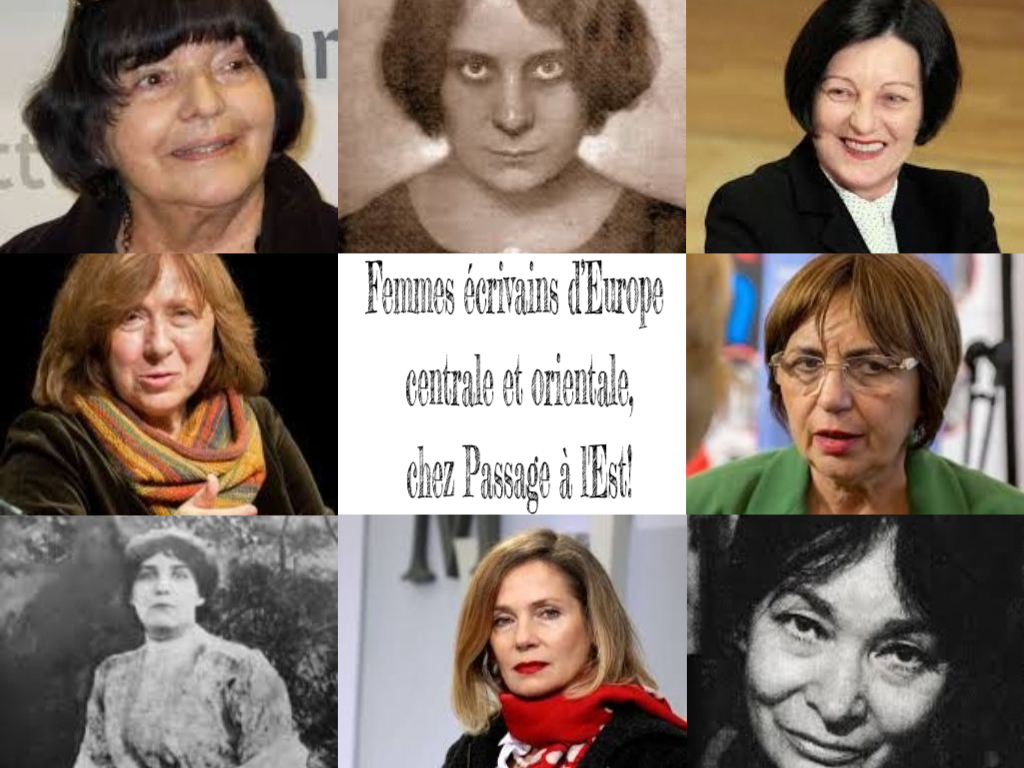Borislav Pekić – The houses of Belgrade
Publié : 10/02/2024 Classé dans : 1970s, En anglais, Monténégro, prix NIN, serbo-croate, Yougoslavie 2 CommentairesNo, sir. I still have some influence. It’s true that I seldom use it, but I still have it. In this town they can’t treat a Negovan as if he were a nobody, a peasant who’s just come from down the hills! Particularly if one takes into account that in my own way I’m one of the builders of Belgrade, one of those people who in civilized countries have streets named after them.
Dans sa version originale, le titre de The houses of Belgrade (Les maisons de Belgrade) est Hodočašće Arsenija Njegovana, « le pèlerinage d’Arsénie Negovan ». Ces différents titres se complètent bien, puisque les maisons ne sont pas juste des maisons de Belgrade : ce sont celles du personnage éponyme, qu’après une absence de 27 ans il s’apprête à retrouver.
Lire la suite »Ivo Andrić – Contes de la solitude
Publié : 09/10/2023 Classé dans : serbo-croate, Yougoslavie | Tags: Andric 21 CommentairesMa dernière lecture d’Ivo Andrić date de l’année dernière : c’était Omar pacha Latas et j’avais trouvé dans ce gros roman « un de ces grands tableaux des siècles passés, présentant un grand thème – un paysage, un passage de la Bible, une bataille entre deux armées – mais dont l’intérêt réside en fait dans les détails nichés sur les routes et dans les maisons ». En particulier, je me souviens d’un de ces « détails » que l’on pourrait s’imaginer figurer de préférence sur le bord du tableau, un peu en arrière-plan : il s’agit du départ, avec une petite colonne d’autres prisonniers enchaînés, de « Mouïaga Télalaguitch », un riche et illustre boutiquier de Sarajevo, tombé en disgrâce. Ce chapitre du départ – qui est aussi une sortie du roman, car Mouïaga Télalaguitch n’y apparait plus – fait suite à d’autres chapitres plus statiques, car ayant pour sujet l’installation du séraskier Omer pacha : il y a par exemple cet épisode de l’audience que donne Omer pacha à tous les pachas et chefs de Bosnie-Herzégovine et à laquelle « même le vizir de Mostar, Ali pacha Rizvanbégovitch » se rend « après une brève hésitation ».


Cet Ali pacha Rizvanbégovitch, j’ai été surprise et amusée de le retrouver dans la deuxième des nouvelles qui, avec une douzaine d’autres, compose le court recueil des Contes de la solitude (2001 pour mon édition chez L’esprit des péninsules, mais disponible en réédition chez Zulma depuis ce printemps). Andrić y donne une autre lecture de cette audience (Ali pacha Rizvanbégovitch, se croyant rusé, y envoie son fils plutôt que de s’y présenter lui-même) et la fin de l’histoire du pacha, qui (dans mon souvenir) ne figure pas dans Omer pacha Latas, prend dans les Contes de la solitude, une tournure similaire à celle de Mouïaga Télalaguitch : la disgrâce, l’arrestation, le départ pour « l’Asie » avec une colonne d’autres prisonniers enchaînés.
Au nombre des sabots et à leur martèlement, je sais quand il chevauche en tant que vizir et maître de l’Herzégovine et quand il le fait en tant que prisonnier vaincu. Lorsque c’est le vizir et seigneur qui passe, il ne m’adresse qu’un salut négligent, sans jamais s’arrêter ; et lorsqu’il s’agit de l’esclave et condamné, il marque une légère pause sous ma fenêtre et échange avec moi, à voix basse, quelques phrases banales. Dans le premier comme dans le second cas il est clair que, par ces fréquents passages, il me laisse entendre qu’il me faut lui ouvrir la porte de mon histoire et lui accorder la place qui lui appartient.
Lire la suite »
Ivo Andrić – Omer pacha Latas
Publié : 15/06/2022 Classé dans : 1970s, Classiques, Nobel, Roman historique, Yougoslavie | Tags: Andric 13 Commentaires
La quatrième de couverture présente les personnages d’Omer pacha Latas comme les figures d’un échiquier – la reine, le fou, la tour, les soldats… En repensant à ma lecture, je me suis rendu compte que j’y voyais plutôt un de ces grands tableaux des siècles passés, présentant un grand thème – un paysage, un passage de la Bible, une bataille entre deux armées – mais dont l’intérêt réside en fait dans les détails nichés sur les routes et dans les maisons.
Le grand thème, ici, serait l’arrivée en Bosnie d’Omer pacha Latas et de son armée, « un grand événement non seulement pour Sarajevo mais pour toute la Bosnie ». C’est au mois d’avril d’une année dont on apprend plus tard qu’il s’agit de celle de 1850 qu’arrive ce séraskier du sultan, « le « mouchir » (maréchal) Omer pacha.
Lire la suite »Alexandre Tišma – Le livre de Blam
Publié : 02/02/2021 Classé dans : 1970s, Holocauste, Yougoslavie | Tags: Tišma 12 Commentaires En lisant Le livre de Blam, j’ai retrouvé l’Alexandre Tišma que j’avais tant aimé en découvrant d’abord L’usage de l’homme (chroniqué en 2012) puis Le jeune fille brune (chroniqué en 2018). Cet écrivain né en 1924, décédé en 2003, y parle, avec une écriture attentive et légèrement exigeante, de la Voïvodine serbe-yougoslave de l’après-guerre, des gens qui y habitent, d’une société qui se transforme petit à petit mais où le poids individuel du passé collectif reste très présent.
En lisant Le livre de Blam, j’ai retrouvé l’Alexandre Tišma que j’avais tant aimé en découvrant d’abord L’usage de l’homme (chroniqué en 2012) puis Le jeune fille brune (chroniqué en 2018). Cet écrivain né en 1924, décédé en 2003, y parle, avec une écriture attentive et légèrement exigeante, de la Voïvodine serbe-yougoslave de l’après-guerre, des gens qui y habitent, d’une société qui se transforme petit à petit mais où le poids individuel du passé collectif reste très présent.
Par sa location et son sujet, Le livre de Blam se rapproche cependant davantage de L’usage de l’homme (qui lui fait suite dans une trilogie lâche que conclut Le Kapo), que de la pure nostalgie personnelle de La jeune fille brune. Le cadre est celui de Novi Sad, cette grande ville multi-ethnique du nord de la Serbie où a grandi l’auteur, et où est né Blam, son héros triste et solitaire. Lire la suite »
Timothée Demeillers – Demain la brume
Publié : 17/09/2020 Classé dans : 2020s, France, Service Presse, Yougoslavie | Tags: Demeillers 8 CommentairesL’autre jour, je prenais un café avec une amie. Il faisait beau, l’ombre commençait à gagner notre coin de rue, nous avions épuisé le sujet du coronavirus et, je ne sais pas pourquoi, nous avons commencé à parler des guerres en Yougoslavie. C., un peu plus âgée que moi, m’a parlé de l’effet que ces guerres avaient eu sur ses choix professionnels. En 1991, lorsque la Slovénie a déclaré son indépendance, elle finissait le lycée dans un petit village autrichien. Voisine de la Slovénie, l’Autriche s’est retrouvée aux premières loges lorsque l’armée yougoslave et les toutes nouvelles forces slovènes se sont disputé le contrôle des postes-frontières, et plus encore lorsque des avions de l’armée yougoslave ont pénétré l’espace aérien autrichien. Plus tard, lorsque le conflit entre, d’une part, la Serbie et, d’autre part, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, s’est intensifié, l’Autriche s’est aussi retrouvée parmi les premiers pays à accueillir les nouveaux réfugiés. La proximité du conflit, la mise en danger du territoire autrichien, tout cela a marqué son esprit d’adolescente. Bien que plus éloignés, beaucoup de Francais.es ont sûrement aussi été marqués par les images de massacres et de bombardements d’il y a à peine trente ans, et par l’égrenage de noms de lieux devenus maudits – Vukovar, Srebrenica, Sarajevo…
 Vukovar, c’est justement là, juste après le siège de cette ville des bords du Danube, que se termine Demain la brume, le troisième roman de Timothée Demeillers, jeune (1984) écrivain français dont je n’ai découvert l’existence qu’en recevant cet été des éditions Asphalte un exemplaire du livre paru avec la rentrée littéraire de septembre. Si l’on peut voir le roman comme l’expression d’un phénomène social – la curiosité qui reste importante pour le dernier conflit armé (avant l’incursion russe en Ukraine) à s’être déroulé en Europe –, on y lit aussi et surtout le portrait d’une tranche de société – les jeunes adolescents et adultes – qui sont parmi les plus vulnérables dans les situations de guerre : vulnérables, parce que plus démunis face aux discours propagandistes, et aussi parce qu’ils porteront les séquelles du conflit à travers toute leur vie d’adulte. Pour faire ce portrait, Timothée Demeillers a l’habileté de se reposer sur le matériau qu’il connait le mieux – l’adolescence française, la vie des villes de province dans la France des années 1990 – et de jouer sur le contraste avec les années-charnière de l’éclatement de la Yougoslavie, afin de mieux éclairer son propos. Ainsi, le roman alterne-t-il les récits-réminiscences plus ou moins étoffés de plusieurs adolescents, Katia, Damir, Nada et Jimmy, et d’extraits de journal d’une quatrième adolescente, Sonja.
Vukovar, c’est justement là, juste après le siège de cette ville des bords du Danube, que se termine Demain la brume, le troisième roman de Timothée Demeillers, jeune (1984) écrivain français dont je n’ai découvert l’existence qu’en recevant cet été des éditions Asphalte un exemplaire du livre paru avec la rentrée littéraire de septembre. Si l’on peut voir le roman comme l’expression d’un phénomène social – la curiosité qui reste importante pour le dernier conflit armé (avant l’incursion russe en Ukraine) à s’être déroulé en Europe –, on y lit aussi et surtout le portrait d’une tranche de société – les jeunes adolescents et adultes – qui sont parmi les plus vulnérables dans les situations de guerre : vulnérables, parce que plus démunis face aux discours propagandistes, et aussi parce qu’ils porteront les séquelles du conflit à travers toute leur vie d’adulte. Pour faire ce portrait, Timothée Demeillers a l’habileté de se reposer sur le matériau qu’il connait le mieux – l’adolescence française, la vie des villes de province dans la France des années 1990 – et de jouer sur le contraste avec les années-charnière de l’éclatement de la Yougoslavie, afin de mieux éclairer son propos. Ainsi, le roman alterne-t-il les récits-réminiscences plus ou moins étoffés de plusieurs adolescents, Katia, Damir, Nada et Jimmy, et d’extraits de journal d’une quatrième adolescente, Sonja.
C’est donc à des kilomètres de la frontière serbo-croate que débute le roman, dans la petite ville de Nevers (« Nevers et son insupportable quiétude »). Katia, lycéenne, punk, n’a rien à voir avec la Yougoslavie, et continuera tout au long du roman à n’avoir quasiment rien à voir avec la Yougoslavie : ce qui l’intéresse, c’est son rejet du « monde de cons » qui l’entoure (« à une époque tout aussi naze »), son avenir de poétesse punk, et Pierre-Yves, dont elle est tombée raide dingue après une manifestation « en ce mois de novembre 1990 ».
Au fond, je ne savais pas grand-chose sur quoi que ce soit mais ça n’avait aucune importance.
« Ici » : c’est le nom de tous les chapitres de Katia, contrastant avec le « Là-bas » qui, à Hvar, à Zagreb et à Vukovar, rassemble Damir, sa cousine Nada et leur copain Jimmy. Damir, « Yougoslave convaincu », « de père serbe et de mère croate » et Jimmy, fils de diplomate, sont à l’orée de la gloire : grâce à leur première composition, Fuck you Yu, ils s’apprêtent à lancer leur groupe des Bâtards Célestes dans le monde du rock yougoslave. Fuck you Yu, c’est un peu comme une expression plus policée de l’anti-systémisme et de la rébellion adolescente de Katia, à deux détails près. Là où la posture qu’adopte Katia n’a de conséquences que pour elle, les cousins yougoslaves se retrouvent face à la censure. Plus grave, d’hymne à la jeunesse et la liberté, la chanson est détournée en chant nationaliste juste au moment où les discours croates et serbes (mais surtout croates dans ce roman) se durcissent avant, bientôt, d’être suivies d’actes.
« Tu sais, Damir, parfois les gens changent, et pas toujours comme on s’y attend. »
« Là-bas », les voix de Damir, Nada et Jimmy vont diverger à mesure que chacun est poussé dans un camp ou dans l’autre. Le camp serbe pour l’un, le camp croate pour l’autre, l’exil pour le troisième : la répartition des rôles pourrait être très classique. Pourtant, tout en s’identifiant à chacun d’eux pour retranscrire leurs choix, leurs motivations et les pressions qui pèsent sur eux, et en laissant à chacun de ses personnages une part d’insondable, Timothée Demeillers évite des schémas trop attendus.
Demeillers s’abstient de montrer une préférence pour l’un ou pour l’autre, mais le plus énigmatique de tous reste le personnage de Pierre-Yves. Il est le seul à ne pas avoir de voix propre dans le roman, et pourtant il est le seul à relier « Ici » – dans sa relation avec Katia, et « Là-bas » – dans son engagement auprès des miliciens croates, peut-être similaire à celui des Occidentaux partis lutter avec ou contre Daesh il y a quelques années. Son personnage est inspiré d’un Français (le blog L’or des livres évoque l’histoire de ce Jean-Michel Nicollier), mais c’est surtout son rôle au sein du roman qui m’a intéressé. Seul élément faisant un lien à la fois ténu et fort entre deux mondes qui, sinon, ignorent tout l’un de l’autre, mais en même temps élément dont tant la personnalité que les actes restent inexplicables, il rassemble par son absence intrigante toutes les couches du mille-feuille de ce roman.
Je lis très rarement la littérature française ultra-contemporaine, et j’ai aussi apprécié ce roman (notamment sa première partie) parce qu’il contient tant de repères qui sont (étaient) également les miens : France Info, les trains Corail et les RER, les cartes téléphoniques prépayées et les noms d’hommes politiques d’un autre temps, qui émaillent le quotidien de Katia. N’étant ni croate, ni serbe, ni yougoslave, mon expérience de la Croatie est irrémédiablement celle d’une étrangère, et je ne peux donc pas dire si Demeillers rend avec autant de succès et de véracité la texture de la vie dans la Croatie d’avant la guerre. Cette qualité d’évocation m’a cependant paru moins présente dans la dernière partie sur la descente dans l’enfer de la bataille pour Vukovar (un épisode dont on suppose que l’auteur n’a heureusement pas d’expérience directe), où l’accent est mis sur l’évolution des personnages dans le contexte du conflit. Le personnage de Nada, si gentil à ses débuts (du moins tel qu’évoqué dans les souvenirs de Damir), devient si sévère, si absorbée par son nouvel entourage nationaliste, et cela si rapidement, que j’avais du mal à m’imaginer qu’il s’agissait de la même fille de même pas vingt ans. C’est un peu dommage, car Damir, Jimmy, Katia et même Sonja, à travers les quelques extraits de son journal, paraissent bien plus complets, avec leurs failles, leurs forces, leurs hésitations.
J’ai fait référence à la chronique du livre chez L’or des livres, mais Demain la brume semble avoir déjà bénéficié d’une couverture médiatique assez étoffée, notamment sur les blogs : chez Charybde27, Garoupe, Quatre sans quatre, Aires Libres et tout récemment La page qui marque, par exemple, avec des avis complémentaires et généralement très positifs.
Je me réjouis de cette visibilité pour le livre et son auteur, mais je verse aussi une petite larme pour les romans étrangers de la rentrée littéraire, tels qu’Adios cow-boy de l’auteure croate Olja Savičević, pour lesquels je tarde à voir le même engouement alors qu’ils le méritent tout autant !
Avec cette chronique de Demain la brume, je termine ma courte série sur la littérature récente de et autour de la Croatie, qui avait justement commencé avec Adios cow-boy avant d’enchaîner sur Les turbines du Titanic (de Robert Perišić), deux excellents romans – et écrivains – croates contemporains récemment traduits en français.
Timothée Demeillers, Demain la brume. Asphalte, 2020.
Danilo Kiš – Jardin, cendre
Publié : 01/07/2020 Classé dans : 1960s, Yougoslavie | Tags: Danilo Kis 9 Commentaires Je n’avais pas prévu de lire Jardin, cendre si tôt. L’été dernier, j’avais pensé le mettre à mon programme, quand j’avais commencé à dévider ma pelote « Europe centrale, années trente » avec Sándor Márai, puis François Fejtö et enfin Miroslav Krleža. Danilo Kiš appartient à une autre génération que ces trois écrivains déjà actifs durant l’entre-deux-guerres, puisqu’il est né en 1935. Mais j’avais pensé à lui parce que, comme le peintre Petar Dobrović, ami de Krleža, que François Fejtö avait rencontré près de Dubrovnik lors de son Voyage sentimental, et comme Krleža lui-même, Danilo Kiš vivait dans un espace « yougoslave » où la frontière linguistique et culturelle avec la Hongrie était encore assez poreuse. Ainsi cet écrivain né (comme Dezső Kosztolányi 50 ans auparavant) à Subotica, décédé à Paris en 1989, et décrit parfois comme serbe, parfois comme yougoslave, parlait-il hongrois comme son père juif d’expression hongroise.
Je n’avais pas prévu de lire Jardin, cendre si tôt. L’été dernier, j’avais pensé le mettre à mon programme, quand j’avais commencé à dévider ma pelote « Europe centrale, années trente » avec Sándor Márai, puis François Fejtö et enfin Miroslav Krleža. Danilo Kiš appartient à une autre génération que ces trois écrivains déjà actifs durant l’entre-deux-guerres, puisqu’il est né en 1935. Mais j’avais pensé à lui parce que, comme le peintre Petar Dobrović, ami de Krleža, que François Fejtö avait rencontré près de Dubrovnik lors de son Voyage sentimental, et comme Krleža lui-même, Danilo Kiš vivait dans un espace « yougoslave » où la frontière linguistique et culturelle avec la Hongrie était encore assez poreuse. Ainsi cet écrivain né (comme Dezső Kosztolányi 50 ans auparavant) à Subotica, décédé à Paris en 1989, et décrit parfois comme serbe, parfois comme yougoslave, parlait-il hongrois comme son père juif d’expression hongroise.
C’est autre chose qui m’a poussé, cette fois-ci, à sortir le livre de l’étagère où je l’avais posé après l’avoir acheté il y a deux ans. Ou plutôt c’est un autre nom, celui d’Edouard Sam, un nom que j’ai mentionné dans ma chronique de Sonnenschein, de Daša Drndić, ce « roman documentaire » où personnages réels et fictifs se succèdent pour faire un portrait sans concessions de l’Europe du XXe siècle nazi. Personnage réel, ou personnage fictif, que cet Edouard Sam, inspecteur des chemins de fer ? Un peu des deux, car l’Edouard Sam de Daša Drndić est aussi celui qui traverse les pages du roman de Danilo Kiš, lui-même fortement inspiré du père de l’auteur. Lire la suite »
Zoran Ferić – Le piège Walt Disney
Publié : 19/10/2019 Classé dans : 1990s, Chloé Billon, Croatie, Nouvelles publications, Service Presse, Yougoslavie | Tags: Ferić 11 Commentaires Les Editions de l’Eclisse sont, à ma connaissance, toutes petites et toutes récentes. C’est au hasard d’un échange avec leur co-fondatrice Laura Karayatov que j’ai appris leur existence, et celle de leur plus récente parution, la deuxième au catalogue après un roman sur la culture du vélo, Les étoiles brilleront dimanche, de Benjamin Coissard (un troisième titre, L’évangile selon Nick Cave, d’Arthur-Louis Cingualte, est prévu pour février prochain). J’aurais pu l’interroger sur l’éclectisme de son catalogue, mais je vais ici me contenter de parler du recueil de nouvelles qu’elle m’a gentiment fait parvenir.
Les Editions de l’Eclisse sont, à ma connaissance, toutes petites et toutes récentes. C’est au hasard d’un échange avec leur co-fondatrice Laura Karayatov que j’ai appris leur existence, et celle de leur plus récente parution, la deuxième au catalogue après un roman sur la culture du vélo, Les étoiles brilleront dimanche, de Benjamin Coissard (un troisième titre, L’évangile selon Nick Cave, d’Arthur-Louis Cingualte, est prévu pour février prochain). J’aurais pu l’interroger sur l’éclectisme de son catalogue, mais je vais ici me contenter de parler du recueil de nouvelles qu’elle m’a gentiment fait parvenir.
Le nom de Zoran Ferić ne parlera probablement qu’à une minorité de lecteurs francophones – et c’est normal car il s’agit là de son premier livre à paraître en français – mais il est bien connu en Croatie où, nous dit la traductrice Chloé Billon dans son introduction, il « a souvent défrayé la chronique » par son humour (« noir et grinçant ») ainsi que par son traitement (« singulier et sans fard ») de la sexualité, entre autres thèmes. Après avoir publié des nouvelles dans des journaux pendant une douzaine d’années, Zoran Ferić a publié son premier recueil de nouvelles, Le piège Walt Disney, en Croatie en 1996 (il est également professeur de littérature et préside l’Association des écrivains croates).
Que rajouter à ces éléments biographiques, sinon que j’espère que l’originalité de ce premier recueil lui permettra d’être mieux connu en France ? Lire la suite »
Miroslav Krleža – Le retour de Philippe Latinovicz
Publié : 19/08/2019 Classé dans : 1930s, Autriche-Hongrie, Fiction, Yougoslavie | Tags: Krleža 9 CommentairesEurope centrale, années trente
De retour dans sa ville natale après de nombreuses années d’absence, un homme se retrouve à nouveau confronté aux questionnements qui le taraudent depuis l’enfance : qui est-il ? d’où vient-il ? où va-t-il ?
Le cadre de ce roman, écrit en croate et publié en 1932, est celui d’une petite ville de Pannonie au nord de la Croatie, et son personnage un peintre talentueux d’une quarantaine d’années, probablement inspiré de la vie de son auteur, l’écrivain Miroslav Krleža (1893-1981).
- Miroslav Krleža
Miroslav Krleža est le pont qui nous mène, après le Voyage sentimental de François Fejtö, à la dernière partie de cette série sur l’Europe centrale littéraire des années trente. J’ai déjà un peu évoqué la rencontre en 1934 entre Fejtö, alors journaliste-écrivain en herbe de 25 ans, et son aîné à la réputation bien assise en Yougoslavie, que Fejtö décrit dans son Voyage sentimental et dans ses Mémoires. Il découvrit alors en Krleža un écrivain qui parlait hongrois, ayant été élève de l’école militaire de Pécs (sud de la Hongrie) puis de l’académie militaire Ludovika de Budapest. Krleža écrirait plus tard avoir égaré son exemplaire du Voyage sentimental mais, comme il le notait dans son Journal, il se souvenait bien de la visite du jeune Hongrois qu’il pensait être le premier à s’intéresser, sur la rive nord de la Drave, aux travaux de Krleža (un autre écrivain hongrois, László Németh, avait en fait déjà écrit sur Krleža et sa pièce de théâtre Messieurs les Glembay).
Mais peut-être un autre lien avait-il aussi, plus tard, existé entre ces deux hommes, par le biais d’une troisième personne, Clara Malraux. Celle-ci est en effet l’auteure, avec Mila Djordjevic, de la traduction française du roman, parue en 1957 aux éditions Calmann-Lévy (qui l’a réédité en 1988 et 1994). A la fin des années 1940, alors que la Yougoslavie de Tito avait rompu avec l’URSS, Clara Malraux (alors déjà depuis longtemps séparée d’André) avait pris fait et cause pour le régime titiste et avait visité le pays à deux reprises, en 1948 et 1949. Quelques années plus tard, elle s’était essayée à la traduction, et le premier résultat publié semble avoir été Le retour de Philippe Latinovicz (quelques années plus tard sortait aussi sa traduction d’Une chambre à soi, de Virginia Woolf).
Je n’en ai pas la preuve, mais je ne serais pas étonnée que Fejtö ait eu un rôle à jouer dans ce choix de traduire Krleza, car non seulement Fejtö gardait des liens étroits avec la Yougoslavie, il était aussi proche de Clara Malraux qui lui avait fourni un refuge dans une maison de campagne près de Cahors pendant la guerre, et avec laquelle il allait plus tard acheter une maison de vacances dans un village proche de Paris.
 Tout cela nous éloigne beaucoup du monde de ce Philippe Latinovicz, héros du roman de 1932, roman aux tonalités sombres mais sur lequel le poids de la guerre, de l’Holocauste et du communisme, qui allaient marquer la littérature plus tardive, ne se fait pas encore ressentir. S’il est un environnement qui donne son empreinte à l’atmosphère du livre, c’est bien celui de l’Autriche-Hongrie et de ses derniers feux. A son retour au pays, après près de 25 ans passés dans les grandes villes de l’ouest de l’Europe, Philippe Latinovicz retrouve ainsi une société qui, contrairement à lui, a stagné dans le souvenir des anciens repères sociaux et géographiques. Autour de lui, ou plutôt autour de sa mère, l’énigmatique Regina, s’est organisé un petit cercle social dont les noms et les titres fleurent bon l’empire multi-ethnique : au premier rang d’entre eux se trouve le vieux Liepach, admirateur de Regina, qui se berce des souvenirs du temps où il était Son Excellence Dr. Liepach de Kostanjevec, Haut-Commissaire du District et personnage important de l’entourage du comte Uexhell-Cranensteeg. Si sa sœur, Mme von Rekettye de Retyezát, veuve du Conseiller du Gouverneur, vieille dame n’ayant pas quitté le style des années 1890, est encore une adepte des corsets en os de baleine, le Dr. Liepach, lui, garde encore précieusement l’invitation au banquet organisé en octobre 1895 à l’occasion de la visite de Sa Majesté le Roi et Empereur, et qui avait rassemblé tout ce que la société locale avait de mieux.
Tout cela nous éloigne beaucoup du monde de ce Philippe Latinovicz, héros du roman de 1932, roman aux tonalités sombres mais sur lequel le poids de la guerre, de l’Holocauste et du communisme, qui allaient marquer la littérature plus tardive, ne se fait pas encore ressentir. S’il est un environnement qui donne son empreinte à l’atmosphère du livre, c’est bien celui de l’Autriche-Hongrie et de ses derniers feux. A son retour au pays, après près de 25 ans passés dans les grandes villes de l’ouest de l’Europe, Philippe Latinovicz retrouve ainsi une société qui, contrairement à lui, a stagné dans le souvenir des anciens repères sociaux et géographiques. Autour de lui, ou plutôt autour de sa mère, l’énigmatique Regina, s’est organisé un petit cercle social dont les noms et les titres fleurent bon l’empire multi-ethnique : au premier rang d’entre eux se trouve le vieux Liepach, admirateur de Regina, qui se berce des souvenirs du temps où il était Son Excellence Dr. Liepach de Kostanjevec, Haut-Commissaire du District et personnage important de l’entourage du comte Uexhell-Cranensteeg. Si sa sœur, Mme von Rekettye de Retyezát, veuve du Conseiller du Gouverneur, vieille dame n’ayant pas quitté le style des années 1890, est encore une adepte des corsets en os de baleine, le Dr. Liepach, lui, garde encore précieusement l’invitation au banquet organisé en octobre 1895 à l’occasion de la visite de Sa Majesté le Roi et Empereur, et qui avait rassemblé tout ce que la société locale avait de mieux.
Son Excellence le Commissaire du District, Dr. Liepach de Kostanjevec, avait vécu ses moments les plus heureux dans le glamour de l’Empire d’Autriche, et il avait passé le reste de ses jours à rêver de cette époque distante, cette « époque inoubliable qui, en toute probabilité, ne reviendrait jamais. » *
On sent chez Krleža une pointe de dérision lorsqu’il décrit ce monde fardé, pétri d’hypocrisie derrière ses bonnes manières. Pourtant, c’est plutôt l’irritation que la dérision qui perce dans le personnage de Philippe Latinovicz : la distance, et le changement d’époque (Krleža reste délibérément vague quant à la période mais on ne peut que supposer qu’il s’agit des années 1930), conduisent inévitablement à la confrontation entre Philippe et cette génération plus âgée avec laquelle il n’a pas grand-chose en commun.
Autour de Philippe, personnage qui nous apparait comme totalement solitaire malgré son succès artistique, s’est créé un autre cercle qui ne fait que renforcer cette impression de fossé : Bobočka, sorte de femme fatale, et son amant l’ancien fonctionnaire distingué Vladimir Baločanski/Ballocsanszky (les deux orthographes utilisées simultanément dans le roman illustrent aussi la fluidité des identités et la porosité des frontières linguistiques) se sont affranchis du carcan des mœurs sociales, sans pour autant indiquer une voie qui pourrait mener Philippe vers la vie plus apaisée qu’il espérait retrouver.
Et ici, au premier plan, juste devant ce verre gris et trouble, se trouvait un homme dont le regard était tourné vers le café réfléchi par le miroir : un homme pâle, en manque de sommeil, fatigué, grisonnant, les yeux lourdement cerclés de noir et une cigarette allumée entre les lèvres, nerveux, éreinté, traversé de frissons, buvant un verre de lait tiède et s’interrogeant sur l’identité de son « ego ». Cet homme doutait de l’identité de son « ego ». Cet homme doutait de l’identité de sa propre existence, et il était arrivé ce matin, et n’était pas revenu dans ce café depuis onze ans.*
Hormis la question de l’art et du lien entre art et artiste, celle de ce qui fait un individu est l’un des fils conducteurs du livre. C’est surtout le cas au cours des premiers chapitres alors que Philippe, tout juste arrivé en ville après toutes ces années d’absence, tente de réajuster son identité actuelle au manteau de souvenirs qui l’attendent dans les cafés, les rues et les bâtiments qu’il avait fréquentés dans son adolescence et qui, eux, semblent n’avoir pas du tout changé.
La mémoire et la nostalgie sont alors très présents, et m’ont inéluctablement fait penser aux héros du hongrois Gyula Krúdy, notamment à celui de N.N., écrit une dizaine d’années avant Le retour de Philippe Latinovicz et dans lequel un homme incertain quant à ses origines revient dans sa région d’origine après de longues années d’absence (la connexion entre Krúdy et Krleza a certainement été facilitée dans mon esprit par le fait que certaines œuvres de Krúdy portées au cinéma l’ont été avec comme acteur principal un certain Zoltán Latinovits).
Dans leur présentation du court récit Enterrement à Thérésienbourg de Krleža, traduit en français et publié chez elles en 1994, les Editions Ombres citent d’ailleurs Krúdy comme l’un des auteurs auxquels Krleža peut être comparés, aux côtés également de Kafka, de Musil et de Canetti.
Miroslav Krleža est assez facilement accessible en français, car hormis ces deux traductions plus anciennes de Le retour de Philippe Latinovicz et d’Enterrement à Thérésienbourg et d’autres publications des années 1970, trois de ses œuvres ont été publiées récemment en français : les pièces de théâtre Messieurs les Glembay et Golgotha (2017 et 2018, aux éditions Prozor), et son roman Banquet en Blithuanie (2019, aux éditions Inculte).
Roman d’un homme et d’un pays confrontés à un tournant dans leurs vies respectives, Le retour de Philippe Latinovicz témoigne aussi d’une entreprise artistique propre à Miroslav Krleža : son style, hésitant toujours à s’attacher à un point de vue narratif précis, donne au lecteur, comme à son héros, l’impression d’être en prise avec une réalité dont les bords sont estompés et presque insaisissables.
Miroslav Krleža est considéré comme le plus important écrivain croate de Yougoslavie. Né à Zagreb en 1893, décédé à Zagreb en 1981, il était quasiment le contemporain de celui qui est considéré comme le plus important écrivain de Yougoslavie d’origine bosnienne, Ivo Andrić.
* N’ayant pas la traduction française sous la main, j’ai lu le roman dans sa traduction anglaise (qui ne m’a pas tout à fait convaincue) ; les traductions sont de moi et ne prétendent pas être parfaites.
Svetlana Velmar-Janković – Dans le noir
Publié : 02/06/2019 Classé dans : 1990s, Alain Cappon, Femmes écrivains, Yougoslavie | Tags: Velmar-Janković 15 Commentaires Il y a des livres dont la force principale réside dans la ténacité silencieuse qui se dégage de leurs personnages, plutôt que dans le style de l’écriture ou dans les rebondissements de l’intrigue.
Il y a des livres dont la force principale réside dans la ténacité silencieuse qui se dégage de leurs personnages, plutôt que dans le style de l’écriture ou dans les rebondissements de l’intrigue.
Dans le noir, méditation sur le siècle et sur la nature du temps et des souvenirs, est de ceux-là. L’écriture, fine et resserrée, nous encourage à nous glisser dans le rythme des pensées de Milica Pavlović alors que celle-ci se plonge à nouveau dans ses souvenirs. De sa longue vie – 80 années qui correspondent à peu près au XXe siècle – une date en particulier ressort et, récurrente, joue le rôle d’un nœud, autour duquel s’articulent l’avant et l’après de sa vie.
En novembre 1944, l’arrestation de son mari correspond avec la prise de contrôle, par les partisans communistes, d’une ville – Belgrade – ravagée par la guerre et les bombardements. Si le Pr. Dušan Pavlović est arrêté, c’est parce qu’il avait fait le choix de coopérer avec l’occupant allemand. Si Milica Pavlović est, ensuite, traitée pendant de longues années en ennemie du peuple, c’est parce qu’elle vient d’un milieu aisé et instruit contre lequel les nouveaux dirigeants combattent avec un zèle idéologique dont l’histoire montrera, plus tard, à quel point il est fait de faux-semblants.
Cette date de novembre 1944, et quelques autres dates d’avant et après-guerre – évoquant la montée au pouvoir d’Hitler, certains événements de la Seconde Guerre mondiale, ou le développement de la Yougoslave d’après-guerre – fournissent une trame historique légère au roman. Cependant, loin d’être un récit du XXe siècle dans lequel chacun des tournants du siècle laisserait son empreinte sur ses personnages, la perspective est inversée : Dans le noir est plutôt une « traversée » (pour reprendre la description de la quatrième de couverture) personnelle au cours de laquelle j’ai eu l’impression de voir émerger le portrait d’une personne qui, malgré les vicissitudes de sa vie, ne les a pas laissées changer l’essence de sa personnalité. Lire la suite »
Quatre citations en guise de transition
Publié : 30/05/2019 Classé dans : 1980s, 1990s, Roumanie, Yougoslavie | Tags: Adameşteanu, Velmar-Janković Poster un commentaire Voici un avant-goût de ma prochaine chronique qui portera sur Dans le noir, de Svetlana Velmar-Janković, un très beau roman serbe, publié en 1990 et qui fait vivre, par la voix d’une femme âgée et solitaire, une partie du XXe siècle. En le lisant juste après Une matinée perdue de Gabriela Adameşteanu, j’ai été frappée par certains échos entre ces deux romans, malgré les différences de style évidentes.
Voici un avant-goût de ma prochaine chronique qui portera sur Dans le noir, de Svetlana Velmar-Janković, un très beau roman serbe, publié en 1990 et qui fait vivre, par la voix d’une femme âgée et solitaire, une partie du XXe siècle. En le lisant juste après Une matinée perdue de Gabriela Adameşteanu, j’ai été frappée par certains échos entre ces deux romans, malgré les différences de style évidentes.
***
Au-dessus d’elle, accroché au mur, un grand tableau sombre, qui montrait un vieux bonhomme en train d’éplucher une pomme. Ce tableau, combien de fois elle l’a vu, Vica !
– Pourquoi vous le gardez, cet affreux ? qu’elle disait. Moi, la nuit, il me flanquerait la frousse.
– Oh ! Vica, c’est un tableau de grande valeur, fait par un peintre d’autrefois. Je le rencontrais chaque été au bord de la mer Noire, à Balcik, et il me l’a offert quand il a vu qu’il me plaisait.
Je me trouvais devant cette même petite toile intitulée Au bain, et l’exposition rétrospective Sava Šumanović de Belgrade était ouverte depuis quelques minutes.
– Toujours amoureuse de cette toile ? me demanda-t-il. (…)
– Vous savez mieux que quiconque combien cette toile m’est chère, dis-je. Depuis l’instant ou je vous ai vu y travailler, vous vous souvenez ? Dans ce petit atelier que vous aviez rue Denfert- Rochereau : en octobre 1928, rappelez-vous…
***
– La nuit tombée, si on entendait une voiture s’arrêter dans la rue, on ne bougeait plus, on se regardait, blancs comme un linge… Cette année-là, tant que je vivrai, je ne l’oublierai pas. Qu’elles étaient longues les minutes, les secondes pendant lesquelles on attendait des pas dans l’escalier, des coups à la porte ! On n’osait même pas aller regarder à la fenêtre, voir ce que c’était, cette voiture.
Déjà on sonnait à la porte, avec impatience, comme dans le scénario que je m’étais imaginé et qui me hantait depuis quelques jours, un scénario apparemment réaliste mais que, dans ma frayeur, je rejetais en me persuadant que, truffé de détails empruntés au banal, il manquait par trop d’authenticité et de réalisme. Mais déjà l’un de ces détails, « les coups de sonnette impatients avant minuit », se réalisait, venait de se réaliser, et sans qu’il y eût là quoi que ce soit de banal.
***
Gabriela Adameşteanu, Une matinée perdue (Dimineaţă pierdută, 1984). Traduit du roumain par Alain Paruit. Gallimard, 2005.
Svetlana Velmar-Janković, Dans le noir (Lagum, 1990). Traduit du serbo-croate par Alain Cappon. Phébus, 1997.