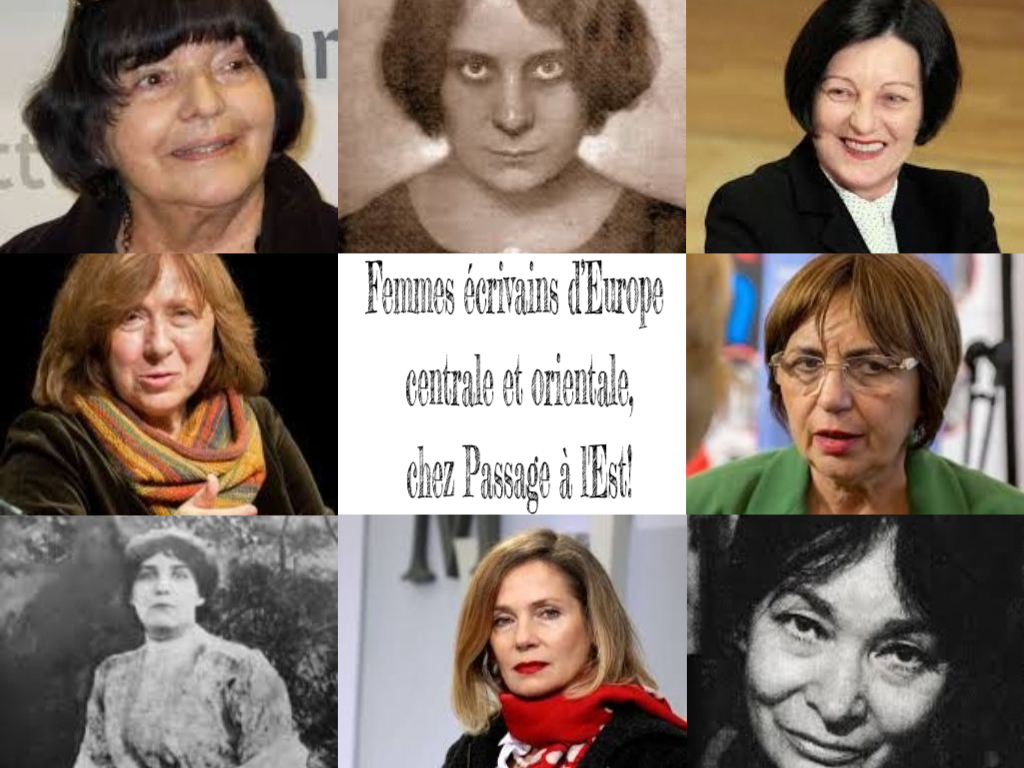Szilárd Borbély – La miséricorde des cœurs
Publié : 30/04/2024 Classé dans : 2010s, Hongrie, Vie rurale | Tags: Szilárd Borbély 6 CommentairesBeaucoup de gens vont à l’autocar du matin. Ils ne voyagent nulle part, ils regardent seulement qui va ce jour-là quelque part.

L’exposition permanente du musée matyó de Mezőkövesd en Hongrie, visitée après ma lecture de Le vinaigre et le fiel, récit de la vie de Margit Gari, replace la summásság (travail agricole saisonnier) dans le contexte économique et agricole d’une politique régionale de répartition des terres qui, à la fin du XIXe siècle, crée toute une catégorie de familles paysannes sans terres : les nincstelen. Nincstelenek – le pluriel de nincstelen, traduisible par les « démunis » ou, comme dans l’édition anglaise, les « dépossédés » –, c’est aussi le titre original du roman de Szilárd Borbély, traduit en français et publié sous le titre bien plus lyrique, extrait du roman, La miséricorde des cœurs. Ce livre se déroule à l’extrémité orientale, la plus pauvre, de la Hongrie, à la fin des années 1960 et dans les années 1970, soit à peu près au même moment que Margit Gari enregistre les souvenirs de sa propre vie. Il s’agit d’un texte à forte dimension autobiographique, profondément dénué d’espoir, seul roman d’un représentant éminent des lettres hongroises qui a, il y a dix ans cette année, peu après la parution de ce livre, mis fin à ses jours.
Lire la suite »Goran Petrović – Sous un ciel qui s’écaille
Publié : 23/08/2023 Classé dans : 2010s, Serbie | Tags: Goran Petrovic 8 CommentairesTout à coup, à peu près au milieu de la projection, sans aucun signe annonciateur, comme si quelque chose d’invisible l’avait intercepté, le pinceau de lumière venu de derrière le dos des spectateurs s’est affaissé, puis a cassé net. Quelque chose a émis un râle, proprement suffoqué et pour finir a claqué ! L’écran aussitôt a pâli. Est devenu gris. Puis a de nouveau brillé. Le projecteur n’envoyait plus qu’un éclat d’une blancheur aveuglante. On pouvait y distinguer nettement deux taches et trois rapiéçages sommaires.
Au premier moment, personne n’a réagi.

Il y a quelques mois, je me promenais dans Saint-Etienne à la recherche d’un endroit pour dîner et je suis ressortie de chez un bouquiniste avec Sous un ciel qui s’écaille. Non seulement ce roman était le seul livre d’Europe centrale, de l’Est ou des Balkans de toute la boutique et m’a donc sauté dans les bras, mais en plus c’était un livre de Goran Petrović, auteur serbe dont j’avais beaucoup apprécié l’univers gentiment fantaisiste dans Soixante-neuf tiroirs.
Lire la suite »Filip David – La maison des souvenirs et de l’oubli
Publié : 01/02/2023 Classé dans : 2010s, Holocauste, Serbie 11 CommentairesLe lendemain, le professeur se rendit à pied au site, autrefois, du camp de Zemlin. Il descendit du pont Branko, traversa la prairie herbeuse et rejoignit Staro sajmište, un ensemble de pavillons décrépits près desquels ont poussé des cabanes qu’habitent aujourd’hui des réfugiés et des Tsiganes. Même si des dizaines de milliers de personnes y avaient trouvé la mort, rien ne laissait penser que, jadis, se dressait ici le premier camp d’internement des juifs, devenu par la suite un camp de transit. Il parvint à l’endroit où, récemment, des terrassiers installant des canalisations avaient découvert la boîte qui avait changé sa vie.
A Belgrade l’année dernière, j’avais logé quelques jours dans un hôtel à Novi Beograd, un peu en retrait du point de rencontre du Danube et de la Save, face au quartier d’affaires alors encore en construction. Un matin, je regardais un plan de la ville pour voir si je pouvais identifier l’endroit où avait été situé le camp de Staro Sajmište. Quelle avait été ma surprise de voir qu’il se trouvait presque littéralement sous mes pieds, ou du moins à seulement quelques minutes de marche de l’ensemble d’hôtels, de bureaux et de centre commercial qui avait poussé là de manière assez artificielle. Avant de quitter Belgrade, je m’étais rendue sur ce morceau de terrain en bordure de rivière : à peu près 10 ans après la publication du livre de Filip David dont est extraite la description ci-dessus, l’endroit, bien qu’habité, était parcouru d’herbes folles et sentait la marginalité et l’abandon.
Lire la suite »Svetlana Alexievitch – La fin de l’homme rouge, ou le temps du désenchantement
Publié : 01/12/2022 Classé dans : 2010s, Femmes écrivains, Lectures communes, Nobel, Non-fiction, URSS | Tags: Alexievitch 21 CommentairesÇa fait rien si je vous parle de moi, si je vous raconte ma vie ? On a tous eu la même vie. Seulement, faudrait pas qu’on m’arrête à cause de cette conversation. Y a encore un pouvoir soviétique, ou c’est complètement fini ?
Quelles conditions faut-il réunir pour mener à bien un travail tel que celui qui a abouti à la publication de La fin de l’homme rouge ? Je ne parle pas uniquement des conditions matérielles, bien que celles-ci soient sûrement non-négligeables pour une entreprise qui s’étend sur deux décennies et parcourt le vaste territoire de l’ex-URSS. Je parle surtout des conditions propices au partage d’histoires personnelles, c’est-à-dire : la confiance, l’absence de peur, l’absence (au niveau d’une société) de raisons d’avoir peur. Sans ce « temps du désenchantement » des années d’après la chute de l’URSS, un livre tel que celui-ci n’aurait eu aucune raison d’exister, ou seulement de manière spéculative. Mais un livre de cette nature, fondé sur des témoignages oraux, aurait-il pu exister durant la majeure partie de l’existence de l’URSS, avec le risque qu’il comportait de remettre en cause les discours, les valeurs et l’histoire officiels ?
Lire la suite »Eugen Ruge – In Zeiten des abnehmenden Lichts (Quand la lumière décline)
Publié : 15/11/2022 Classé dans : 2010s, Allemagne de l'Est, En allemand, Lectures communes 9 Commentaires
J’ai encore les trois petites coupures de la sélection « Books of the Year » d’un Financial Times de novembre 2013, trois papiers roses avec les titres qui m’avaient le plus intéressé à l’époque parmi leur sélection des meilleurs livres de l’année. Il y avait The War that Ended Peace, de Margaret Macmillan, Harvest, de Jim Crace, et In Times of Fading Light, d’Eugen Ruge. Le premier livre est celui d’une grande spécialiste de la Première Guerre mondiale et porte sur la première décennie et demie du XXe siècle ; j’ai lu son Peacemakers/Les artisans de la paix, sur la conférence de paix de 1919, mais pas encore celui-là. Le deuxième titre, je l’ai lu au printemps 2020 et j’ai expliqué peu après pourquoi je l’avais tant aimé. Quant au troisième, il s’agit du titre de la traduction anglaise d’un roman de 2011, disponible également en français sous le titre Quand la lumière décline.
Le petit descriptif du Financial Times utilise exactement 50 mots pour parler de ce « premier roman » primé et qui retrace un demi-siècle d’histoire de l’Allemagne de l’Est à travers l’histoire de l’apparatchik Wilhelm Powileit : « cette saga familiale retranscrit, tout en détails, la réalité de la vie quotidienne en RDA », y est-il entre autres écrit.
Lire la suite »Maryla Szymiczkowa – Madame Mohr a disparu
Publié : 10/11/2022 Classé dans : 2010s, Pologne, Roman historique | Tags: Szymiczkowa 19 CommentairesUne chose était évidente à ses yeux : en aucun cas Ignacy ne devait deviner que sa femme, au lieu de se consacrer aux occupations propres à son sexe, à sa position et aux règles d’un mariage honnête, folâtrait dans des bâtiments d’utilité publique à la recherche d’un étrangleur-assassin.
J’étais en vacances dans le sud de la Hongrie quand j’ai lu ce livre pour la première fois. C’était vers la mi-février, il faisait beau mais froid et, après une journée passée dehors, c’était assez agréable de passer la soirée avec un livre ou trois, au son du ronronnement soporifique, entrecoupé d’éternuements occasionnels, du vieux convecteur au gaz qui s’efforçait tant bien que mal de dissiper la fraîcheur ambiante. Madame Mohr a disparu, ce sympathique roman polonais, était vraiment une lecture appropriée pour ces soirées tranquilles, les dernières, d’ailleurs, avant le 24 février.



La traduction anglaise était déjà sur mes étagères, acquise par curiosité et sur la base de la confiance presque aveugle que j’ai envers le travail de la traductrice Antonia Lloyd-Jones, et après l’avoir écoutée dans un très réjouissant entretien avec les auteurs du livre au festival Noirwich (repéré grâce à MarinaSofia, merci à elle !). C’est donc cette traduction anglaise (Mrs Mohr goes missing) que j’ai d’abord lue mais, pour cette chronique, j’ai relu le livre dans la traduction française, publiée fin août par Agullo qui m’en ont gentiment fait parvenir un exemplaire.
A propos d’un précédent Agullo, justement, j’avais déjà écrit qu’en tant que lectrice je me situe « dans la catégorie « Agatha Christie », c’est-à-dire quelque part entre novice et débutant sur l’échelle de la violence et du glauque » (cela ne m’avait pas empêché d’apprécier ledit Agullo, qui se situe pourtant à l’autre extrémité de l’échelle). Madame Mohr a disparu se situe en tout cas dans cette même catégorie « Agatha Christie », ou dans ce qu’on peut appeler aujourd’hui le cozy crime. J’imagine cependant que les deux victimes du roman auraient beaucoup à redire au mot « cozy », la première ayant vu sa vieillesse tranquille abrégée par l’absorption d’un poison et la seconde ayant été retrouvée prématurément morte dans son lit quelques jours plus tard.
Lire la suite »Weronika Gogola – Par petits bouts
Publié : 30/10/2022 Classé dans : 2010s, Femmes écrivains, Pologne, Service Presse 11 Commentaires
Par petits bouts est le cinquième roman de Belleville Editions (et premier roman de Tropismes Editions) que je lis : cinq romans très récents, pour cinq univers très différents. J’avais commencé avec L’empire de Nistor Polobok, ce petit roman de Iulian Ciocan sur la Moldavie post-soviétique, que j’avais décrit comme « une fable apocalyptique à l’humour grinçant ». J’avais continué avec Blue Moon, de Damir Karakaš, « portrait à la première personne d’un jeune lambda de Zagreb, à la fin des années 1980 ». Puis était arrivé Et on entendait les grillons, de Corina Sabău, « récit d’un drame personnel, dont la traductrice Florica Courriol contextualise également très utilement la dimension sociale dans son introduction », ce roman stylistiquement complexe étant celui d’une femme dans la Roumanie de Ceausescu. Le suivant, que je n’ai pas encore chroniqué, était celui d’un homme dans la Serbie d’aujourd’hui, le héros de Errance de Filip Grbic étant « un personnage égaré dans un monde où il ne trouve pas sa place ».
Et voici donc Par petits bouts, roman du quotidien, d’une enfant qui grandit et dans lequel il se passe à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. A vrai dire, j’hésite même à utiliser le mot « roman » tant le livre épouse, de manière visiblement autobiographique, le point de vue de cette enfant sur une vie qui n’a pas nécessairement besoin de l’intervention d’une autrice pour suivre son cours.
Lire la suite »Levan Berdzenichvili – Ténèbres sacrées. Les derniers jours du Goulag
Publié : 26/01/2022 Classé dans : 2010s, Géorgie, Service Presse, URSS | Tags: Berdzenichvili 14 Commentaires– Quels sont les objectifs de votre parti ? demanda Socrate.
Ion énonça avec aisance le programme modeste de son jeune parti :
– L’enterrement du système communiste, l’indépendance de la Géorgie et l’instauration de la démocratie.
Socrate, très cérémonieux et le visage grave, demanda :
– D’où un Grec tient-il cette passion pour la Géorgie ?
– Si le grand Socrate œuvre pour la grande Ukraine, pourquoi est-il impossible que le petit Ion le fasse pour la petite Géorgie ? demanda Ion, qui pesait au moins deux fois plus que Socrate.
Socrate, imperturbable :
– Alors, les trois à la fois, n’est-ce pas ? Renversement du communisme, indépendance, démocratie.
Ion s’enhardit :
– C’est ça. Dieu est Trinité.

Je n’avais pas encore lu Ténèbres sacrées lorsque j’ai annoncé qu’il y aurait du rire dans mon programme – sinon assez sombre – de janvier, et je ne l’avais pas non plus encore lu quand j’ai décidé de l’associer à Les beaux jours de l’enfer dans une petite séquence sur les intellectuels au Goulag. Mais je ne me suis pas trompée : le livre a beau se dérouler entièrement dans un camp de travail soviétique, on ne peut s’empêcher de rire à la lecture du récit – reconstruction en partie fictionnalisée – de trois années d’emprisonnement de l’auteur et de la célébration de ses codétenus d’alors.
Lire la suite »En Hongrie et en URSS, les tribulations d’intellectuels du XXe siècle
Publié : 22/01/2022 Classé dans : 1960s, 2010s, Géorgie, Hongrie, URSS Poster un commentaireAprès deux romans sur la Seconde Guerre mondiale en Bulgarie et en Yougoslavie sous occupation hongroise, et après deux récits de déportation au Kazakhstan et en Sibérie sous Staline, voici bientôt deux récits littéraires empreint d’humour et d’absurde, dont le thème commun est le goulag (façon Hongrie des années 1950 et URSS des années 1980), tel que vécu par des intellectuels.
Le premier est un livre dont la traduction française est tellement confidentielle que même la bibliothèque nationale hongroise s’avoue vaincue : impossible de mettre la main sur un exemplaire de l’édition française (1965). Je me suis donc rabattue sur la version anglaise (1962) de ce texte dont l’original hongrois n’a officiellement paru en Hongrie qu’en 1989. Il s’agit de Les beaux jours de l’enfer, du poète hongrois György Faludy.
>>> Retrouvez ma chronique sur ce lien
Le second sera bien plus facile à trouver dès qu’il aura paru en traduction française (aux éditions Noir sur Blanc le 10 février ; publication originale en 2010). Il s’agit de Ténèbres sacrées. Les derniers jours du Goulag, de l’universitaire et homme politique géorgien Levan Berdzenichvili.
>>> Retrouvez ma chronique sur ce lien


C’est sur Passage à l’Est !, et c’est à partir de demain.
Théodora Dimova – Les dévastés
Publié : 09/01/2022 Classé dans : 2010s, Bulgarie, Femmes écrivains, Lectures communes, Nouvelles publications, Service Presse | Tags: Dimova 32 CommentairesPlus tard, tout au long de la journée, la radio retransmit régulièrement la proclamation. Le précédent gouvernement avait été renversé, mais on ne disait ni pourquoi ni comment. Cela n’empêchait pas le présentateur de poursuivre : les partisans descendaient massivement des montagnes. La population sortait pour les accueillir avec du pain et du sel. Sa joie était double : elle avait d’abord accueilli les soldats soviétiques, elle accueillait maintenant les partisans. Elle les parait de fleurs, scandait « mort au fascisme », et là, le présentateur semblait avoir du mal à réprimer ses larmes.
(…)
Et seulement un mois plus tard, la réalité commença lentement à se déformer et à surpasser ses craintes les plus profondes. Seulement un mois plus tard, ses peurs commencèrent à ressembler à d’inoffensives visions au regard de ce qui se produisait.
Une femme, par une nuit glaciale d’hiver, erre dans son appartement, incapable de se concentrer sur autre chose que ses pensées fébriles et son attente d’un messager qui ne vient pas.
Lire la suite »