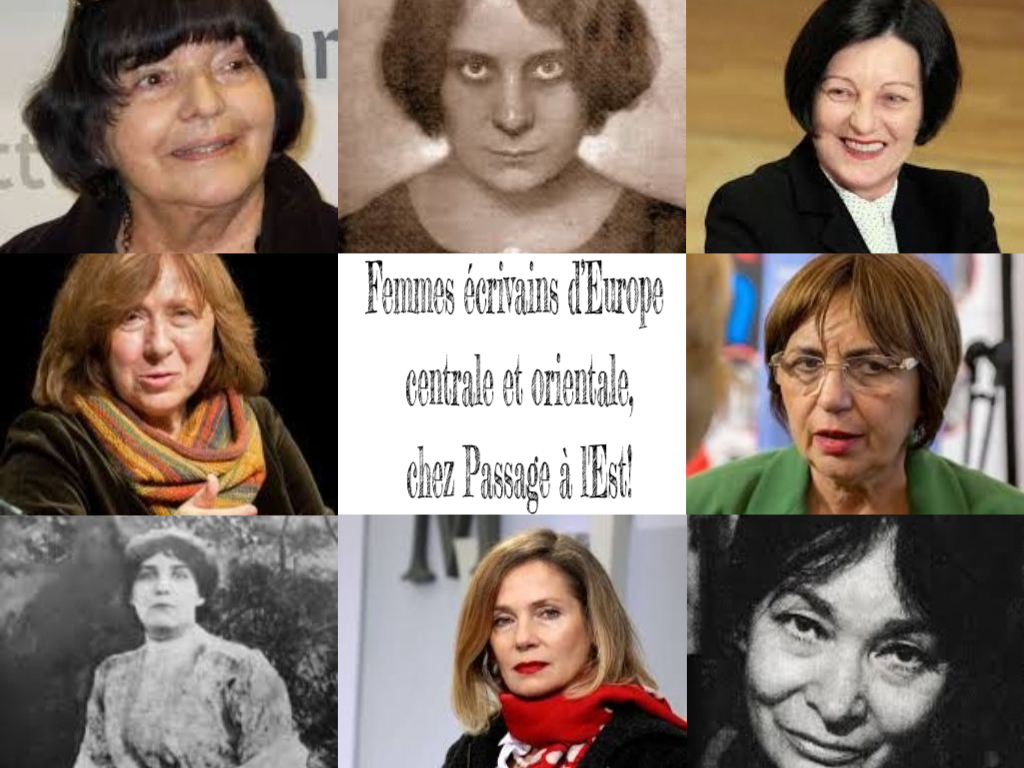4/11 : Ça s’est passé un 1er mai – 11 livres de la « nouvelle Europe »
Publié : 13/05/2024 Classé dans : Anniversaire, Europe, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Union européenne | Tags: Maslowska, Soltész, Totth, Šindelka Poster un commentaireParler de la littérature de ces trente dernières années, pour marquer le 20e anniversaire de l’élargissement de 2004 (en y ajoutant ceux de 2007 et 2013) : c’est – comme je l’avais expliqué ici le jour même de ce 20e anniversaire – l’objectif de ce billet.
J’y propose chaque jour, un pays et un livre avec pour ligne directrice : un livre qui laisse de côté l’Histoire du XXe siècle pour se concentrer sur le monde contemporain.
Commentaires et suggestions sont les bienvenus !

4/11: MAGYARORSZÁG

Le roman se déroule dans une Hongrie où les abattoirs sont déjà aux normes européennes, mais il pourrait se dérouler dans n’importe quel pays où il y a de la drogue, des voitures de sport, des filles, et des ados en quête de sensations. Percutant de bout en bout, traversé par la violence mais porté par une langue – et une traduction – travaillée jusqu’à la rendre d’une grande fluidité, le titre d’aujourd’hui est :
Comme des rats morts, de Benedek Totth. Billet en cours de préparation !
« Portrait désespérant de justesse d’une certaine adolescence contemporaine, Comme des rats morts est un roman noir sombre et brillantissime. Une sorte de Trainspotting à la piscine. Un choc. » (source)
Titre original : Holtverseny (2014). Une traduction du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, publiée chez Actes Sud en 2017.

3/11: ČESKO

Les deux titres entre lesquels j’hésitais pour aujourd’hui ont pour point commun le regard qu’ils portent sur un monde qui va bien au-delà des frontières de la Tchéquie. Celui que j’ai finalement choisi porte une histoire terriblement universelle et terriblement humaine – celle de l’impact de la migration sur le corps et sur l’esprit, mais il est aussi le reflet d’un pays confronté à un phénomène migratoire qui lui avait auparavant été étranger.
Il s’agit de : La fatigue du matériau, de Marek Šindelka, et j’en avais parlé dans ce billet.
« La fatigue du matériau est une tentative pour imaginer une voix à ceux qui n’en ont pas en littérature, ou du moins pas encore : celle de migrants prêts à tout pour quitter leurs communautés détruites, et rejoindre un endroit où ils pensent pouvoir construire un avenir. »
Titre original : Únava Materiálu (2016). Une traduction du tchèque par Christine Laferrière, publiée par les éditions des Syrtes en 2021.

2/11: SLOVENSKO

Cette liste de titres en lien avec le 20e anniversaire de l’élargissement me trottait déjà dans la tête au moment des élections parlementaires de l’automne de l’année dernière. A la consternation de beaucoup, c’est le populiste et pro-russe Robert Fico qui s’est une nouvelle fois retrouvé à diriger le gouvernement. De la Slovaquie de Fico à celle que dépeint l’écrivain (d’abord journaliste) Arpád Soltész, il n’y avait qu’un pas que j’ai franchi allégrement en choisissant un titre pour ce pays.
Il s’agit de : Le bal des porcs, d’Arpad Soltész et j’en avais parlé dans ce billet.
« Le bal des porcs commence comme un roman, et se termine comme un réquisitoire, noir et amer, contre une corruption qui ronge en profondeur « une région qui pourrait bien être la Slovaquie mais qui ne l’est pas vraiment. »
Titre original : Sviňa (2018). Une traduction du slovaque par Barbora Faure, publiée par Agullo en 2020.

1/11: POLSKA
Pour commencer cette série, direction la Pologne, avec un roman écrit à 150 à l’heure et publié juste avant l’adhésion de la Pologne à l’UE (cette UE qui y fait d’ailleurs une petite apparition) : dans une banlieue d’une ville du littoral baltique, il nous plonge dans l’univers de « Le Fort » et ses amis, jeunes désœuvrés et accros, entre rêves et psychoses.

C’est : Polococktail Party, de Dorota Masłowska et j’en avais parlé dans ce billet.
« Hormis la curiosité de savoir ce qu’il va se passer jusqu’à la fin du livre, et où cette histoire de guerre masquée contre les Russes et leur contrebande va nous mener, c’est la langue du roman qui m’a donné envie de le lire jusqu’au bout : une langue hachée, avec un vocabulaire assez répétitif même lorsqu’il s’agit d’explétifs, mais qui forme au bout du compte le portrait d’un jeune homme qui n’a pas grand-chose à quoi arrimer sa vie. »
Titre original : Wojna polsko ruska pod flagą biało-czerwona (2002). Une traduction du polonais par Zofia Bobowicz, publiée par les éditions Noir sur Blanc en 2004.
3/11 : Ça s’est passé un 1er mai – 11 livres de la « nouvelle Europe »
Publié : 11/05/2024 Classé dans : Anniversaire, Europe, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Union européenne | Tags: Maslowska, Sindelka, Soltész 1 commentaireParler de la littérature de ces trente dernières années, pour marquer le 20e anniversaire de l’élargissement de 2004 (en y ajoutant ceux de 2007 et 2013) : c’est – comme je l’avais expliqué ici le jour même de ce 20e anniversaire – l’objectif de ce billet.
J’y propose chaque jour, un pays et un livre avec pour ligne directrice : un livre qui laisse de côté l’Histoire du XXe siècle pour se concentrer sur le monde contemporain.
Commentaires et suggestions sont les bienvenus !

3/11: ČESKO

Les deux titres entre lesquels j’hésitais pour aujourd’hui ont pour point commun le regard qu’ils portent sur un monde qui va bien au-delà des frontières de la Tchéquie. Celui que j’ai finalement choisi porte une histoire terriblement universelle et terriblement humaine – celle de l’impact de la migration sur le corps et sur l’esprit, mais il est aussi le reflet d’un pays confronté à un phénomène migratoire qui lui avait auparavant été étranger.
Il s’agit de : La fatigue du matériau, de Marek Šindelka, et j’en avais parlé dans ce billet.
« La fatigue du matériau est une tentative pour imaginer une voix à ceux qui n’en ont pas en littérature, ou du moins pas encore : celle de migrants prêts à tout pour quitter leurs communautés détruites, et rejoindre un endroit où ils pensent pouvoir construire un avenir. »
Titre original : Únava Materiálu (2016). Une traduction du tchèque par Christine Laferrière, publiée par les éditions des Syrtes en 2021.

2/11: SLOVENSKO

Cette liste de titres en lien avec le 20e anniversaire de l’élargissement me trottait déjà dans la tête au moment des élections parlementaires de l’automne de l’année dernière. A la consternation de beaucoup, c’est le populiste et pro-russe Robert Fico qui s’est une nouvelle fois retrouvé à diriger le gouvernement. De la Slovaquie de Fico à celle que dépeint l’écrivain (d’abord journaliste) Arpád Soltész, il n’y avait qu’un pas que j’ai franchi allégrement en choisissant un titre pour ce pays.
Il s’agit de : Le bal des porcs, d’Arpad Soltész et j’en avais parlé dans ce billet.
« Le bal des porcs commence comme un roman, et se termine comme un réquisitoire, noir et amer, contre une corruption qui ronge en profondeur « une région qui pourrait bien être la Slovaquie mais qui ne l’est pas vraiment. »
Titre original : Sviňa (2018). Une traduction du slovaque par Barbora Faure, publiée par Agullo en 2020.

1/11: POLSKA
Pour commencer cette série, direction la Pologne, avec un roman écrit à 150 à l’heure et publié juste avant l’adhésion de la Pologne à l’UE (cette UE qui y fait d’ailleurs une petite apparition) : dans une banlieue d’une ville du littoral baltique, il nous plonge dans l’univers de « Le Fort » et ses amis, jeunes désœuvrés et accros, entre rêves et psychoses.

C’est : Polococktail Party, de Dorota Masłowska et j’en avais parlé dans ce billet.
« Hormis la curiosité de savoir ce qu’il va se passer jusqu’à la fin du livre, et où cette histoire de guerre masquée contre les Russes et leur contrebande va nous mener, c’est la langue du roman qui m’a donné envie de le lire jusqu’au bout : une langue hachée, avec un vocabulaire assez répétitif même lorsqu’il s’agit d’explétifs, mais qui forme au bout du compte le portrait d’un jeune homme qui n’a pas grand-chose à quoi arrimer sa vie. »
Titre original : Wojna polsko ruska pod flagą biało-czerwona (2002). Une traduction du polonais par Zofia Bobowicz, publiée par les éditions Noir sur Blanc en 2004.
2/11 : Ça s’est passé un 1er mai – 11 livres de la « nouvelle Europe »
Publié : 10/05/2024 Classé dans : Pologne, Slovaquie, Anniversaire, Europe, Union européenne | Tags: Soltész Poster un commentaire1/11: Ça s’est passé un 1er mai – 11 livres de la « nouvelle Europe »
Publié : 09/05/2024 Classé dans : Anniversaire, Europe, Pologne, Union européenne Poster un commentaireQuelques nouveaux titres en mai
Publié : 05/05/2024 Classé dans : Nouvelles publications 13 CommentairesQuand j’écrivais que ce récapitulatif des nouvelles parutions n’allait pas m’aider à présenter la littérature ultra-contemporaine parlant d’aujourd’hui, je pensais en particulier au titre suivant :

A l’ombre de la mort, de Rūdolfs Blaumanis, a paru en 1899. En français et sauf erreur, cet auteur parait pour la presque première fois le 23 de ce mois (presque, parce qu’une « version française » de sa « pièce populaire latvienne » C’est demain dimanche a paru en 1926, mais ça n’aide pas grand monde). « Inspiré d’un fait divers, Blaumanis pose dans ce texte bref écrit en 1899 des questions humaines universelles essentielles. À l’ombre de la mort, traduit pour la première fois en français, est un des chefs-d’œuvre de la littérature lettone », explique la présentation des éditions Do qui en publient la traduction, du letton, par Nicolas Auzanneau (qui signe aussi la postface). Le hasard a fait que j’en ai lu récemment une traduction anglaise dans un vieux recueil de nouvelles de Blaumanis, que j’ai beaucoup appréciée.
Lire la suite »Ça s’est passé un 1er mai
Publié : 01/05/2024 Classé dans : Anniversaire, Série, Union européenne 10 CommentairesVous souvenez-vous d’où vous étiez le 1er mai 2004 ? Moi, j’étais en Allemagne, à Aachen/Aix-la-Chapelle, une ville européenne par excellence. Je garde le souvenir d’un jour de fête et d’un jour important pour l’Europe, mais je ne pense pas avoir vraiment réalisé à ce moment-là ce que pouvait signifier l’élargissement ce jour-là de l’Union européenne à dix nouveaux états-membres et à près de 75 millions de personnes. Je ne savais pas non plus à quel point j’allais en profiter – de la liberté de circulation et de séjour notamment – lorsque j’irais vivre, quelques années plus tard, en Hongrie.*
20 années après ce premier mai, l’Union européenne a encore gagné trois états-membres – la Bulgarie et la Roumanie, c’était le 1er janvier 2007, suivies, le 1er juillet 2013, de la Croatie – et (mais est-il vraiment nécessaire de le rappeler ?), perdu un. Quelle chance pour mon blog que presque tous ces « nouveaux » états-membres, ainsi que ceux qui se pressent encore aux portes de l’UE en espérant y accéder, soient tous de ces pays d’Europe « de l’Est » dont les littératures sont moins connues que leurs homologues « de l’Ouest » mais valent réellement la peine d’être mises en avant !
Lire la suite »Szilárd Borbély – La miséricorde des cœurs
Publié : 30/04/2024 Classé dans : 2010s, Hongrie, Vie rurale | Tags: Szilárd Borbély 6 CommentairesBeaucoup de gens vont à l’autocar du matin. Ils ne voyagent nulle part, ils regardent seulement qui va ce jour-là quelque part.

L’exposition permanente du musée matyó de Mezőkövesd en Hongrie, visitée après ma lecture de Le vinaigre et le fiel, récit de la vie de Margit Gari, replace la summásság (travail agricole saisonnier) dans le contexte économique et agricole d’une politique régionale de répartition des terres qui, à la fin du XIXe siècle, crée toute une catégorie de familles paysannes sans terres : les nincstelen. Nincstelenek – le pluriel de nincstelen, traduisible par les « démunis » ou, comme dans l’édition anglaise, les « dépossédés » –, c’est aussi le titre original du roman de Szilárd Borbély, traduit en français et publié sous le titre bien plus lyrique, extrait du roman, La miséricorde des cœurs. Ce livre se déroule à l’extrémité orientale, la plus pauvre, de la Hongrie, à la fin des années 1960 et dans les années 1970, soit à peu près au même moment que Margit Gari enregistre les souvenirs de sa propre vie. Il s’agit d’un texte à forte dimension autobiographique, profondément dénué d’espoir, seul roman d’un représentant éminent des lettres hongroises qui a, il y a dix ans cette année, peu après la parution de ce livre, mis fin à ses jours.
Lire la suite »En livre et en images, une visite à Mezőkövesd, avec Margit Gari (deuxième partie: les images)
Publié : 24/04/2024 Classé dans : 1980s, En visite, Hongrie, Non-fiction, Récit autobiographique, Vie rurale, Voyages | Tags: Edit Fél, Margit Gari 8 CommentairesJ’ai présenté dans la première partie de cet article le récit autobiographique de Margit Gari, paysanne sans terre de la première moitié du XXe siècle hongrois, Le vinaigre et le fiel. J’ai terminé en demandant comment était né ce récit si vivant d’une femme sans éducation ?

via Elte Néprajz Blog
Une annexe du livre apporte justement « quelques précisions sur la naissance du présent ouvrage » et est écrite par l’ethnologue Edit Fél. Née en 1910, décédée en 1988, celle-ci est la presque contemporaine de Margit Gari (1907-1998) mais, fille d’un avocat, elle fait des études qui la mènent jusqu’au diplôme universitaire en 1935. Devenue conservatrice au musée ethnographique de Budapest, elle se spécialise dans l’étude de la vie paysanne hongroise et notamment celle de Mezőkövesd et des Matyós et c’est ainsi qu’elle rencontre Margit Gari qui finira, écrit-elle, par la considérer comme une sorte de « sœur spirituelle ». Lorsque, au cours de nombreuses sessions entre 1970 et 1972, Edit Fél enregistre les souvenirs de Margit Gari en s’entourant d’une petite équipe de collaborateurs, elle s’appuie sur sa propre solide connaissance du milieu particulier des matyós, notamment tel qu’il est vécu par les paysans sans-terre.
Lire la suite »En livre et en images, une visite à Mezőkövesd, avec Margit Gari (première partie: le livre)
Publié : 20/04/2024 Classé dans : 1980s, En visite, Hongrie, Non-fiction, Récit autobiographique, Vie rurale | Tags: Edit Fél, Margit Gari 8 CommentairesNous appelions « gens de Kövesd » tous les groupes venant de la région où les hommes portent des chapeaux hauts et les femmes des jupes amincissantes, nouées immédiatement sous les seins. Tous de bons ouvriers, travailleurs, habiles et sans prétention. (…) Après cinq ou six mois de dur labeur, ils ramenaient chez eux cinq à six quintaux de blé, quarante pengös et des vivres économisés, d’une valeur approximative de vingt pengös. Voilà ce qu’ils remportaient à la maison, à moins qu’à l’encontre de leur décision ils n’en eussent expédié une part, au préalable. Avec cela ils devaient se nourrir pendant tout l’hiver, mais, quelquefois, on avait déjà consommé chez eux, en été, les réserves pour l’hiver.
Dans Ceux des pusztas, Gyula Illyés consacre tout un chapitre aux travailleurs saisonniers engagés pour travailler sur les grandes propriétés : leur logement, leur nourriture, leur conception de l’économie, leurs similarités et différences avec le monde des puszta dans lequel lui a grandi. Le vinaigre et le fiel est justement un document unique sur la vie d’une de ces summás, une femme issue d’une famille de sans-terres et dont la vie dans les années 1920 et 1930 est rythmée par les travaux agricoles saisonniers, sur les domaines de grands propriétaires, aux quatre coins du pays. C’est aussi un aperçu de la culture matyó de la région de Mezőkövesd, au nord-est de Budapest.
Lire la suite »A partir de Giono, deux écrivains hongrois : Gyula Illyés et Áron Tamási (III)
Publié : 17/04/2024 Classé dans : 1930s, Classiques, Hongrie | Tags: Illyés, Tamási 2 CommentairesJe termine, avec cette présentation de Ceux des puszta, de Gyula Illyés, cette série inspirée de ma lecture de Giono et qui m’a menée d’abord vers une lecture d’Ábel dans la forêt profonde, d’Áron Tamási.

L’environnement dans lequel évolue cet Ábel adolescent a beau être rural et proche de la terre, il ne saurait être plus différent de Ceux des pusztas, de Gyula Illyés. Curieusement, Gallimard, dans l’édition de 1969, ajoute le mot « roman » sur la couverture, mais ce doit être une erreur car, même si le narrateur fait en effet parfois prendre au livre les accents d’un roman, il s’agit d’abord d’un texte sociologique qui s’appuie très fortement sur les souvenirs de l’auteur concernant son milieu d’enfance. Plus encore que Tamási, Illyés parle de gens qui sont pauvres parce qu’ils n’ont pas de terres ; contrairement au Giono de Que ma joie demeure, par exemple, ils ne peuvent pas s’interroger sur la mise en commun de terres qui ne leur appartiennent pas. Contrairement à l’Ábel de Tamási, ainsi qu’à la poignée de personnages éparpillés sur le « plateau Grémone » de Giono, loin de la ville mais suffisamment proche pour en entendre parfois la rumeur, le milieu que décrit Illyés ne connait pas la solitude (on y est bien trop nombreux pour ça) mais est en même temps collectivement coupé du monde par le statut de travailleurs des pusztas qui est celui de ses habitants.
Puszta. C’est un mot qu’on retrouve un peu partout sur la carte de la Hongrie dès qu’on la regarde un peu en détail. Il peut évoquer la grande plaine hongroise, celle qui recouvre une grande partie du territoire à l’est du Danube, mais il peut aussi se référer à ce que Gallimard décrit sur la quatrième de couverture comme « un de ces grands domaines seigneuriaux où s’aggloméraient autour du château ces maisonnettes de torchis où vivaient très à l’étroit plusieurs familles » et que d’autres traduisent par latifundia. Illyés en donne lui-même la définition dès la première page :
Lire la suite »