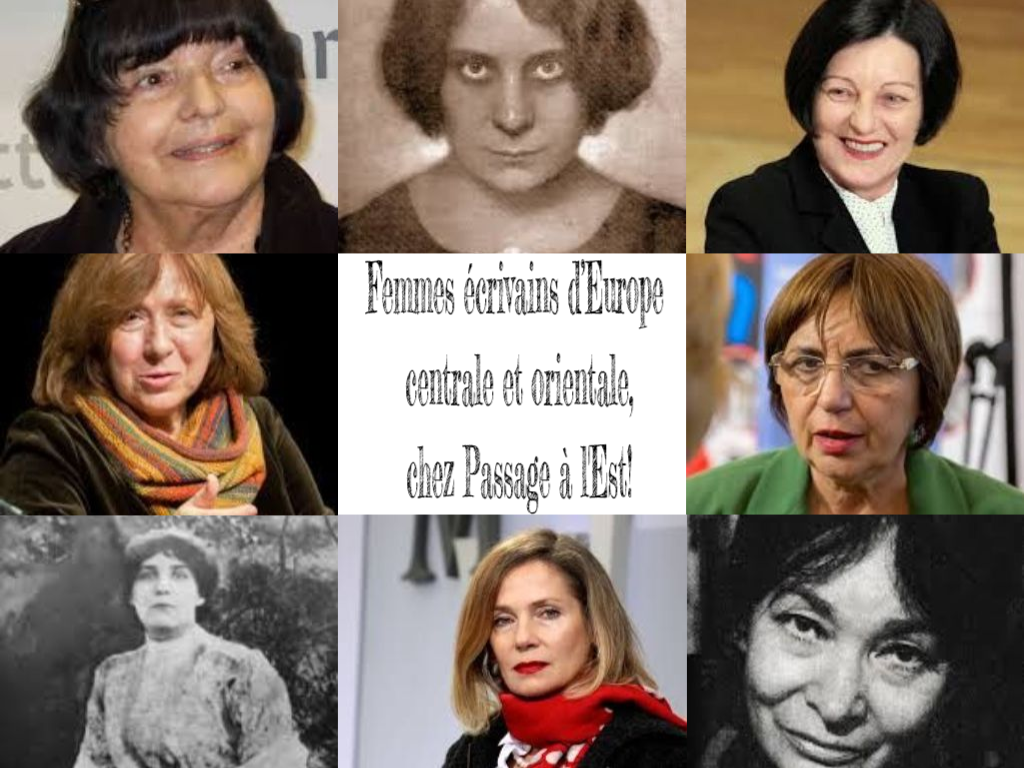David Kldiachvili – Le malheur (suivi d’une promenade culturelle en Géorgie)
Publié : 07/11/2021 Classé dans : 1910s, Géorgie, Histoire littéraire, Mer Noire, Théâtre, Voyages 4 CommentairesAvant d’aller faire un petit tour puis un deuxième en Afrique, et de présenter quelques nouvelles parutions, j’étais en Géorgie dans les années 1990, dans une école d’un quartier anodin de Tbilissi, avec The Pear Field, de Nana Ekvtimishvili. C’est en Géorgie que je vous propose maintenant de retourner, avec d’abord un arrêt dans un village de campagne, au début du siècle dernier. Cet arrêt sera suivi d’un aperçu fantasque – fait de vaches, d’un président perdu, d’une sainte et d’une « mère de » – de la fin du XXe et du début du XXIe siècle géorgien. Avec « Géorgie », le deuxième maître-mot reliant ces deux billets sera « théâtre » et c’est de théâtre que je parlerai ensuite – avec un invité bien au courant – dans un troisième billet.
A la fin de billet de ce premier billet, inspirée par ma lecture et par un voyage récent, je vous parlerai aussi de trois intellectuels géorgiens du début du XXe siècle, d’un trésor en France, et de musique.
Mais donc, d’abord : un village, plusieurs personnages, un malheur.
Lire la suite »Bélarus, fragments littéraires (suite et fin)
Publié : 25/09/2020 Classé dans : Bélarus, Histoire littéraire, Politique 21 CommentairesHier, dans mon introduction à cette promenade littéraire sur le territoire bélarusse, j’évoquais l’une des personnes les plus connues du pays : celui de son dirigeant Alexandre Loukachenko. Aujourd’hui, c’est avec un autre nom, de bien moins sinistre réputation, que je vais véritablement commencer cette promenade : Svetlana Alexievitch.
C’est surtout pour ses écrits sur le XXe siècle soviétique que cette journaliste et écrivaine lauréate du prix Nobel de littérature en 2015, s’est fait connaitre et respecter. D’expression russe, née dans l’ancienne République Socialiste Soviétique d’Ukraine, longtemps installée à Minsk où elle est revenue vivre après plusieurs années d’exil dans les années 2000, le parcours de Svetlana Alexievitch et la censure exercée sur ses livres illustrent autant l’histoire politique de l’ex-URSS que celle du Bélarus indépendant : aujourd’hui encore, nombre de ses livres restent inaccessibles au Bélarus.
Se définit-elle comme bélarusse ? Je lui aurais peut-être posé la question si le Festival International du Livre de Budapest, dont elle était l’invitée d’honneur cette année, avait pu avoir lieu. L’actualité m’a de toute manière apporté un élément de réponse de l’engagement de Svetlana Alexievich dans le conseil de coordination de l’opposition bélarusse dans le cadre des élections présidentielles très contestées de début août. Cet engagement lui a valu d’être d’abord sommée de répondre à un comité d’enquête sur les activités du conseil, avant qu’elle n’annonce craindre une tentative d’enlèvement (elle est l’une des rares membres du comité à n’être ni en prison, ni en exil) : une annonce qui a eu pour résultat ahurissant un défilé d’ambassadeurs européens dans son appartement en signe de soutien.
 C’est en lisant une tribune parue ces derniers jours dans Le Monde que j’ai appris l’existence d’un autre écrivain bélarusse contemporain traduit en français. Sacha Filipenko, né en 1984 à Minsk, est publié aux éditions des Syrtes. Si je ne lui avais pas beaucoup prêté attention, c’est parce que l’auteur est établi en Russie depuis de nombreuses années et qu’il est étiqueté « littérature russe » dans le catalogue des Syrtes. C’est pourtant aussi à Minsk que se déroule Croix rouges, son premier roman traduit en français (par Anne-Marie Tassis-Botton ; les Syrtes ont publié cette année un deuxième roman, La Traque, traduit par Raphaëlle Pache). Comme dans les écrits de Svetlana Alexievitch, la guerre et les vies individuelles au cours du tragique XXe siècle soviétique, forment un arrière-plan fort dans ce roman.
C’est en lisant une tribune parue ces derniers jours dans Le Monde que j’ai appris l’existence d’un autre écrivain bélarusse contemporain traduit en français. Sacha Filipenko, né en 1984 à Minsk, est publié aux éditions des Syrtes. Si je ne lui avais pas beaucoup prêté attention, c’est parce que l’auteur est établi en Russie depuis de nombreuses années et qu’il est étiqueté « littérature russe » dans le catalogue des Syrtes. C’est pourtant aussi à Minsk que se déroule Croix rouges, son premier roman traduit en français (par Anne-Marie Tassis-Botton ; les Syrtes ont publié cette année un deuxième roman, La Traque, traduit par Raphaëlle Pache). Comme dans les écrits de Svetlana Alexievitch, la guerre et les vies individuelles au cours du tragique XXe siècle soviétique, forment un arrière-plan fort dans ce roman.
***
Même si le russe est l’une de deux langues officielles du pays, avec le bélarussien, il prime dans nombre de sphères de la vie publique du pays. Ce pays a toujours eu des liens forts avec la Russie, et auparavant avec l’URSS, et encore auparavant avec la Russie des tsars.
Russe ? Bélarussien ? Vu d’ici, on pourrait croire que les différences sont minimes entre les deux langues, mais il faut faire un bond en arrière dans l’histoire pour comprendre les origines du bélarussien et sa place dans le pays. L’explication qui suit est schématique, car c’est un sujet compliqué, comme toujours quand il s’agit de définir d’une langue et de son importance pour le développement d’une nation. Une partie du territoire actuel, y compris l’actuelle capitale Minsk, a longtemps fait partie de l’empire russe,  mais avant cela la Pologne et la Lituanie, dans leurs incarnations historiques (Grand Duché de Lituanie, Union de la Couronne de Pologne et du Grand Duché…) se sont aussi également étendues sur ce territoire. Lublin (actuelle Pologne), Vilnius (actuelle Lituanie) étaient des villes plus développées que Minsk. La présence de nombreux bélarusses en Pologne et en Lituanie (parmi lesquels l’opposante phare de Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaïa), et inversement la présence d’une minorité polonaise à la frontière occidentale du Bélarus, illustrent l’importance des liens historiques et de la proximité géographique. Nulle surprise donc que la Pologne et la Lituanie soient les deux pays les plus engagés de l’Union européenne contre le régime de Loukachenko. Pour en revenir à l’histoire, ces liens étroits expliquent que le grand poète romantique Adam Mickiewicz, généralement étiqueté comme polonais, né sur le territoire de l’actuel Bélarus, éduqué à Vilnius, orne aussi certains coins de rue de l’ouest du Bélarus. Exilé en Russie, puis en France (il a été professeur au Collège de France), il termine sa vie à Constantinople. Ses Sonnets de Crimée, et Les Aïeux et Pan Tadeusz, ses œuvres maitresses, sont traduites en français chez L’Age d’Homme et Noir sur Blanc.
mais avant cela la Pologne et la Lituanie, dans leurs incarnations historiques (Grand Duché de Lituanie, Union de la Couronne de Pologne et du Grand Duché…) se sont aussi également étendues sur ce territoire. Lublin (actuelle Pologne), Vilnius (actuelle Lituanie) étaient des villes plus développées que Minsk. La présence de nombreux bélarusses en Pologne et en Lituanie (parmi lesquels l’opposante phare de Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaïa), et inversement la présence d’une minorité polonaise à la frontière occidentale du Bélarus, illustrent l’importance des liens historiques et de la proximité géographique. Nulle surprise donc que la Pologne et la Lituanie soient les deux pays les plus engagés de l’Union européenne contre le régime de Loukachenko. Pour en revenir à l’histoire, ces liens étroits expliquent que le grand poète romantique Adam Mickiewicz, généralement étiqueté comme polonais, né sur le territoire de l’actuel Bélarus, éduqué à Vilnius, orne aussi certains coins de rue de l’ouest du Bélarus. Exilé en Russie, puis en France (il a été professeur au Collège de France), il termine sa vie à Constantinople. Ses Sonnets de Crimée, et Les Aïeux et Pan Tadeusz, ses œuvres maitresses, sont traduites en français chez L’Age d’Homme et Noir sur Blanc.
 Si je mentionne Mickiewicz, ce n’est pas pour prétendre qu’il est une figure de la littérature bélarusse, mais plutôt pour illustrer la grande fluidité des frontières de cette partie de l’Europe jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle. C’est aussi pour souligner les différences entre, d’une part, le russe, et d’autre part le bélarussien, celui-là parsemé de mots qui rappellent davantage le polonais. A ma connaissance, peu de livres sont publiés en bélarussien et encore moins traduits en français. La question de la langue est justement au cœur du roman de l’écrivain Alhierd Baharevič (né à Minsk en 1975), Les Enfants d’Alendrier, et publié aux Editions du Ver à Soie en 2018 dans la traduction d’Alena Lapatniova, sous la rédaction de Virginie Symaniec.
Si je mentionne Mickiewicz, ce n’est pas pour prétendre qu’il est une figure de la littérature bélarusse, mais plutôt pour illustrer la grande fluidité des frontières de cette partie de l’Europe jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle. C’est aussi pour souligner les différences entre, d’une part, le russe, et d’autre part le bélarussien, celui-là parsemé de mots qui rappellent davantage le polonais. A ma connaissance, peu de livres sont publiés en bélarussien et encore moins traduits en français. La question de la langue est justement au cœur du roman de l’écrivain Alhierd Baharevič (né à Minsk en 1975), Les Enfants d’Alendrier, et publié aux Editions du Ver à Soie en 2018 dans la traduction d’Alena Lapatniova, sous la rédaction de Virginie Symaniec.
***
La capitale du Bélarus, Minsk, forme un trait d’union évident entre ces trois écrivains contemporains que sont Svetlana Alexievitch, Sacha Filipenko et Alhierd Baharevič : chacun d’entre eux y est né ou y vit. C’est aussi la ville au cœur de l’ouvrage, illustré de photographies, d’Artur Klinau, Minsk, cité de rêve, traduit du russe par Jacques Duvernet aux Editions Signes et Balises (2015). Cité de rêve, Cité du Soleil : ce ne sont pas les expressions qui me seraient spontanément venues à l’esprit à ma première rencontre, l’année dernière, avec cette ville traversée d’artères démesurées, balayées par le vent glacial de novembre, bordées d’immeubles aux façades écrasantes. Mais ce sont deux parmi les nombreuses expressions qu’utilise l’auteur et architecte Artur Klinau pour parler de la ville où il est né, en 1965, dans son récit à mi-chemin entre guide de voyage et autobiographie. Temps de lecture a consacré une longue et riche chronique à ce livre, et je note également d’après le site de l’auteur que le livre, écrit d’abord pour une maison d’édition allemande, existe tant en traduction russe qu’en traduction biélorussienne.
d’entre eux y est né ou y vit. C’est aussi la ville au cœur de l’ouvrage, illustré de photographies, d’Artur Klinau, Minsk, cité de rêve, traduit du russe par Jacques Duvernet aux Editions Signes et Balises (2015). Cité de rêve, Cité du Soleil : ce ne sont pas les expressions qui me seraient spontanément venues à l’esprit à ma première rencontre, l’année dernière, avec cette ville traversée d’artères démesurées, balayées par le vent glacial de novembre, bordées d’immeubles aux façades écrasantes. Mais ce sont deux parmi les nombreuses expressions qu’utilise l’auteur et architecte Artur Klinau pour parler de la ville où il est né, en 1965, dans son récit à mi-chemin entre guide de voyage et autobiographie. Temps de lecture a consacré une longue et riche chronique à ce livre, et je note également d’après le site de l’auteur que le livre, écrit d’abord pour une maison d’édition allemande, existe tant en traduction russe qu’en traduction biélorussienne.
Autour de la ville, il y a la campagne : c’est là, dans une pommeraie en plein hiver, que se déroule La récolte, de Pavel Priajko (né à Minsk en 1975). Portant la mention « traduit du russe (Biélorussie) » et traduit par Larissa Guillemet et Virginie Symaniec, il s’agit là d’une courte pièce de théâtre, présentée en France à partir de 2011 par la Théâtre National de Syldavie et publiée aux Editions L’Espace d’un instant. On retrouve dans ce texte bien peu optimiste les mésaventures de quatre jeunes gens de la ville partis cueillir des pommes en plein hiver, et dont l’expédition va finir teintée d’une violence sourde et avec la dévastation de la pommeraie. Virginie Symaniec, spécialiste du théâtre biélorussien, et Larissa Guillemet, ont aussi dirigé Une moisson en hiver. Panorama des écritures théâtrales contemporaines de Biélorussie (L’espace d’un instant, 2011), avec des textes de A. Tchas, Timofeï Ilievski, Viktar Jyboul, Dmitri Strotsev, Pavel Rassolko, Andreï Kareline, Nikolaï Roudkovski, Andreï Koureitchik et Pavel Priajko.
Pour conclure cette liste, un bref regard sur un segment aujourd’hui quasiment invisible de la population historique du territoire du Bélarus : Lettres de ma mémoire, publié au printemps aux Editions Ver à Soie, est la traduction en français par Alena Lapatniova sous la rédaction de Virginie Symaniec, du témoignage de Hanna Krasnapiorka. Née en 1925, à Minsk, celle-ci est une adolescente lorsque les troupes nazies envahissent sa ville, peu après la rupture du pacte germano-soviétique. Juive, Hanna est assignée dans le ghetto de Minsk et y vit jusqu’à sa destruction en 1943. Pres de trente ans après, alors que l’Holocauste reste un sujet tabou en URSS, elle rassemble ses souvenirs, les étoffant de témoignages et de journaux intimes, et parvient à publier son livre une dizaine d’années plus tard. Il est ici traduit pour la première fois en français, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Cette poignée de titres et de noms d’auteurs glanés ici et là donne un aperçu de la partie de la littérature du Bélarus qui est traduite en français. C’est en quelque sorte la face émergée de l’iceberg, mais il m’est impossible d’évaluer la taille de l’iceberg, ni de dire s’il existe aussi une production littéraire sur le Bélarus au cours de ses 26 années d’existence sous la présidence d’Alexandre Loukachenko. Le principal souvenir emporté de mes visites en librairie au Bélarus, c’est justement le portrait de Loukachenko, toujours accroché au mur, avec des exemplaires prêts à la vente… Espérons que ces portraits de M. Loukachenko ne seront plus pour longtemps suspendu dans les librairies, ou alors que ce sera simplement comme une simple marchandise offerte à la curiosité des touristes.
Bélarus, fragments littéraires (introduction)
Publié : 24/09/2020 Classé dans : Bélarus, Histoire littéraire, Politique 14 CommentairesL’automne dernier, des élections parlementaires anticipées se sont déroulées au Bélarus (Biélorussie), ce plat pays coincé entre la Pologne et la Russie, la Lituanie et l’Ukraine et dont on entend généralement peu parler. Hormis quelques rassemblements dans la capitale, Minsk, et dans quelques autres grandes villes (la Brest du fameux traité de Brest-Litovsk, par exemple), ces élections se sont déroulées dans une
grande apathie, voire même un désintérêt certain, démentant au passage la description de la campagne électorale comme des « bacchanales politiques » par le président du pays, Alexandre Loukachenko. Les résultats officiels ont pris l’allure d’un véritable tour de force : le nouveau parlement – dont le rôle est de toute manière restreint – ne contient aucun député d’opposition.
Cet été, c’était au tour de Loukachenko de se soumettre au vote populaire, pour la sixième élection présidentielle depuis la création de la fonction de président du Bélarus en 1994. La fiche Wikipédia intitulée « Liste des chefs d’Etat de Biélorussie » dit succinctement tout ce qu’il y a à savoir sur ces élections : pour la période 1991-1994, trois hommes se sont succédé comme présidents du Soviet suprême de la République de Biélorussie. Après 1994, seul un nom est donné, celui d’Alexandre Loukachenko avec, d’un côté du tableau Wikipédia, un début de numérotation optimiste (« N° 1 ») et de l’autre une note plus réaliste : « sa présidence devient rapidement autoritaire ».
Pour en revenir aux « bacchanales politiques », c’est surtout après l’annonce des résultats officiels (falsifiés) des élections présidentielles du 9 août qu’elles ont explosé, en forme de rejet massif du président et du régime qu’il incarne depuis un quart de siècle, à coup d’élections truquées. Malgré le climat d’intimidation et de brutalité instauré par les forces de sécurité du régime, les manifestations se succèdent chaque week-end depuis un mois et demi, rassemblant des dizaines voire des centaines de milliers de personnes descendues pacifiquement et courageusement dans la rue, à Minsk et en province. Cette semaine, alors que Loukachenko vient de prêter serment dans le plus grand secret et sans qu’aucun Etat démocratique ait reconnu les résultats des élections, le nombre d’arrestations arbitraires est évalué à plus de 12 000 (pour un peu moins de 10 millions d’habitants). Candidats d’opposition et leurs équipes, journalistes, ouvrier.e.s, étudiant.e.s et personnes âgées, simples passant.e.s, toutes les

Officiellement, le Bélarus a deux langues, mais le bélarusse est souvent relégué au second rang. Ici, un contre-exemple.
tranches de la population sont représentées parmi ces nouveaux prisonniers politiques. Mais les manifestants ne baissent pas les bras, alors qu’au-dessus de leurs têtes les voisins russes et européens du pays font encore leurs calculs pour définir leur posture face à ce nouveau défi géopolitique.
De tous les pays d’Europe centrale, de l’Est et des Balkans dont je parle sur ce blog, le Bélarus est le plus énigmatique au niveau littéraire. Le manque de liberté – politique, économique, culturelle – et d’ouverture – notamment à l’Ouest – y est certainement pour quelque chose. Mais le Bélarus est, aussi, un pays très récent et dont les symboles identitaires et linguistiques sont encore contestés.
J’ai passé plusieurs semaines au Bélarus l’année dernière, justement au moment des élections parlementaires, et c’est par solidarité avec les manifestants que je vous proposerai demain des fragments littéraires sur ce pays fort mal connu. Mon objectif n’est absolument pas d’être exhaustive – je suis de toute manière mal placée pour prétendre à l’exhaustivité – , mais plutôt de rassembler les bribes de connaissances que j’ai accumulées ici et là, surtout en ce qui concerne la littérature traduite en français.
Rendez-vous donc dès demain pour une brève promenade dans la littérature du Bélarus !
Rachel Polonsky – La lanterne magique de Molotov
Publié : 12/01/2019 Classé dans : Histoire littéraire, Russie, Voyages | Tags: Polonsky 7 Commentaires La lanterne magique de Molotov est à la fois le point de départ du livre, et une métaphore pour la méthode qu’emploie Rachel Polonsky tout au long du livre pour dérouler, image par image, son histoire de la Russie.
La lanterne magique de Molotov est à la fois le point de départ du livre, et une métaphore pour la méthode qu’emploie Rachel Polonsky tout au long du livre pour dérouler, image par image, son histoire de la Russie.
Quand j’ai sorti le livre du rayon de la bibliothèque, je me souvenais avoir noté le titre lorsque le livre était sorti en Angleterre en 2010 (la traduction en français chez Denoël date de 2012) et, très vaguement, que c’était à propos d’une maison à Moscou, et puis c’est tout.
C’est bien avec une maison à Moscou que commence ce voyage intellectuel à travers l’histoire et la littérature de la Russie, une maison au passé prestigieux et funeste : située au n°3 de la rue Romanov, c’était d’abord un immeuble à loyer à sa construction à la toute fin du XIXe siècle par la famille des comtes Cheremetiev, puis après la révolution bolchévique et jusqu’à la fin de la période communiste un mélange d’appartements communautaires et de résidence d’Etat pour la nomenklatura : Trotski, Vorochilov, Joukov, Khrouchtchev et d’autres y ont vécu et auraient pu donner leur nom au livre.
The men who lived in No. 3 had metro stations, institutes, cities, battle cruisers, tractors, auto-plants; warhorses, lunar craters and stars named after them. On my walks down to the Lenin Library from our first Moscow apartment on Tverskaya Street, I would choose to come this way, to get closer, I liked to think, to the hidden lives of those men… There are many more names in the invisible nomenklatura of No. 3, names without plaques, erased by state murder or sullen disgrace from the charmed list during every decade of Soviet power: Trotsky, Belovorodov, Sokolnikov, Frumkin, Furtseva, Malenkov, Rokossovsky, Togliatti, Zhukov, Vyshinsky, Kosior, Tevosyan, Khrushchev, Molotov…
Mais lorsque Polonsky s’installe au No. 3 de la rue Romanov à la fin des années 1990, les  derniers appartements communautaires sont en train d’être reconvertis en appartements pour banquiers d’affaires, artistes cotés et présentateurs vedettes. C’est justement un banquier d’affaires – son voisin du dessus- qui lui prête la clé de son appartement en l’informant que Viatcheslav Molotov (ministre des affaires étrangères de l’URSS, entre autres postes de confiance auprès de Staline) avait habité l’appartement et que sa bibliothèque s’y trouvait encore.
derniers appartements communautaires sont en train d’être reconvertis en appartements pour banquiers d’affaires, artistes cotés et présentateurs vedettes. C’est justement un banquier d’affaires – son voisin du dessus- qui lui prête la clé de son appartement en l’informant que Viatcheslav Molotov (ministre des affaires étrangères de l’URSS, entre autres postes de confiance auprès de Staline) avait habité l’appartement et que sa bibliothèque s’y trouvait encore.
Au début, le livre plonge dans l’histoire de ce quartier de Moscou, et du bâtiment, en même temps qu’il est une réflexion sur l’histoire et la mémoire, dans cette ville au centre d’un pays où la mémoire de l’histoire est encore éminemment malléable.
Rachel Polonsky est historienne de la littérature russe, et le livre tire son attrait de la capacité de l’auteur à naviguer les rues de Moscou – du moins celles du centre historique – aussi bien que les différentes couches historiques et les personnages qui se sont succédés pour construire l’histoire de l’empire russe puis de l’URSS. A côté des noms bien connus de Dostoievski, de Mandelstam ou encore de Chalamov, toute une galerie d’autres personnages est évoquée pour rendre la densité de l’histoire que raconte Polonsky : Nikolaï Fiodorov, ancien responsable de la bibliothèque du Musée Roumiantsev de Moscou au XIXe siècle et que Polonsky décrit comme le « Socrate russe » et le pionnier des bibliothécaires ; l’espion des années de la révolution Sidney Reilly et sa coterie de danseuses russes ; les chercheurs Sergueï et Nikolaï Vavilov aux destins divergents mais également terribles sous le stalinisme. Il lui suffit de quelques lignes pour brosser leur portrait et y intéresser ses lecteurs.
Petit à petit, elle élargit son cercle géographique : de l’appartement 61 du N°3 de la rue Romanov, et de ce quartier central de Moscou, on passe aux villages des datchas proches de Moscou, puis on s’éloigne avec elle du centre : Novgorod, Rostov sur le Don, Taganrog, Mourmansk, Oulan Oude se succèdent. Avec ces villes, ce sont aussi leurs personnalités littéraires (Babel, Tchekhov …), militaires (Boudionny), ou encore les exilés de l’insurrection des décembristes de 1825, qui apparaissent au fil des pages. Le livre est un peu comme un pot pourri d’histoire littéraire, d’histoire locale, d’histoire politique, d’histoire tout court, et d’impressions de voyage. Même si c’est fascinant, c’est parfois trop, et on risque de perdre le fil de l’histoire ici ou là. C’est surtout vrai pour les premiers chapitres sur Moscou, très riches et évocateurs, mais un peu déstabilisants tant Polonsky s’autorise à suivre le cours de sa pensée. J’ai fini par me demander s’il s’agissait d’un livre sur Moscou, ou sur une maison et ses habitants, ou encore sur Molotov ?
Dans les derniers chapitres, le contexte politique (la mort de Eltsine, le naufrage du sous-marin Koursk, l’emprisonnement de Mikhaïl Khodorkovsky) se fait plus présent que dans le reste du livre. Mon édition anglaise précise que certains passages avaient d’abord été écrit sous forme de « Lettres » pour la revue Times Literary Supplement : ce sont peut-être ceux-là.
Deux éléments donnent quand même au livre une certaine unité. Le premier est la personne de l’auteur, puisque ce sont les lieux où elle vit ou voyage, et sa connaissance fine de l’histoire russe, qui donnent leur matière aux différents chapitres (sa « lanterne magique »). Il ne s’agit cependant pas d’histoire personnelle, et Rachel Polonsky reste à l’arrière-plan, préférant donner à ses personnages le rôle de vedette. Si on voit percer ses goûts ou ses préférences, c’est sous la forme de références un peu appuyées à telle ou telle personne, comme par exemple l’intellectuel, médiéviste et linguiste Dmitri Likhatchov, ou le photographe Evgueni Khaldeï, témoins et acteurs de ce terrible XXe siècle russe.

Photographie prise par Evgueni Khaldeï pendant la seconde guerre mondiale: Source ici
Le deuxième élément, c’est Molotov et sa bibliothèque. Rachel Polonsky ne se contente pas de voir combien de livres elle contient, ou de dérouler leurs noms et auteurs. Les dédicaces, les annotations, la couleur de l’encre, la qualité du papier (importante pour les livres publiés durant les premières années de la révolution lorsque le papier manquait), le nombre de pages coupées, la présence même dans la bibliothèque de Molotov de livres interdits à la majorité des lecteurs pendant des décennies : pour elle, tout devient un indice, et les livres eux-mêmes deviennent comme des témoins de l’histoire.
Dans sa découverte de la bibliothèque de Molotov, et le voyage à travers la Russie qu’elle nous propose, elle se nourrit aussi des propres lectures, et c’est une belle invitation à ouvrir à notre tour les œuvres de Babel, de Tchekhov, de Pasternak, d’Anna Akhmatova, d’Osip et Nadejda Mandelstam, de Chalamov, de Tchoukovskaïa (dont les romans et les recueils de poèmes et de conversations avec Anna Akhmatova furent interdits de publication dans l’Union soviétique et donc publiés à Paris), de Marina Tsvetaeva et de tant d’autres. C’est aussi une invitation à aller voir, par soi-même ou en photo, les endroits qu’elle décrit… sans non plus les idéaliser : les gardes du corps des nouveaux riches, les dessous politiques de la renaissance de l’église orthodoxe russe, ont aussi toute leur place dans le livre.
En lisant ce livre, j’ai pensé à Emma et à ses désirs frustrés d’escapades littéraires à Moscou, je lui dédie donc cette chronique.
Rachel Polonsky, Molotov’s Magic Lantern. A journey in Russian history. Faber and Faber, 2010. Publié en français chez Denoël : La lanterne magique de Molotov. Voyage à travers l’histoire de la Russie. Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat. Préface de Danièle Sallenave. 2012.